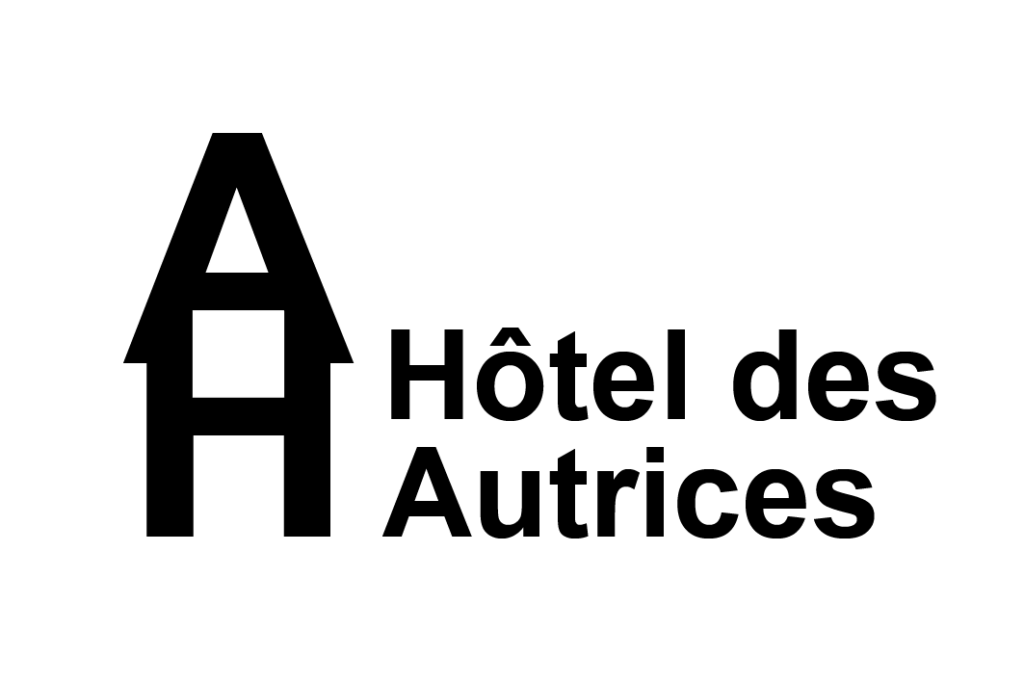Laure Zehnacker
2022A024
La psy de l’hôtel
Les professionnels ont mis longtemps avant de me diagnostiquer. Je suis passée par les cabinets de plusieurs psys avant de faire des tests plus poussés et plus savants. C’est ma mère la première, qui a osé s’attarder sur mon étrangeté. Enfant, je ne pleurais jamais et ce qui semblait être un caractère calme et mûr s’est doucement mué en un je-m’en-foutisme latent. Or, je ne m’en fous pas de vos tristesses, de vos peurs, de vos manques, de vos bonheurs. Je dirais même… qu’ils m’attirent. Je ne suis simplement pas concernée, ni de près ni de loin. Si on me pince la peau, je vais avoir mal. Mon épiderme, comme le vôtre, transpire, se blesse, saigne. Quand j’étais plus jeune, je m’amusais à me scarifier le bout des doigts pour mugir un bref instant quand le couteau ouvrait la chair. À l’inverse, même si j’ai un cœur fonctionnel, je resterai parfaitement insensible à la détresse qui vous ronge de l’intérieur quand un drame se produit.
Psychopathe. Je « souffre » de psychopathie. Contrairement à l’image d’Épinal véhiculée dans les médias, tous les psychopathes ne sont pas destinés à une carrière criminelle plus ou moins réussie. En réalité, il y a des psychopathes qui s’ignorent et ceux qui déraillent complètement. L’environnement familial détermine le destin d’une personne. Si mes parents m’avaient enfermée dans une cave avec du pain sec, je serais sans doute devenue un genre de monstre et j’aurais participé à l’enfer général que Sartre décrit. Mais moi, je suis née dans une famille aimante avec une mère très attentionnée, qui a réussi à me faire comprendre qu’un être humain avait des émotions et qu’il fallait les respecter.
Devant la psy de l’hôtel, dans son petit cabinet, je ne dirai rien de mon anomalie psychique. Je ne suis pas venue pour me faire aider. J’ai décidé de me rendre dans son petit cabinet pour la saisir. Je veux jouer.
Pendant, les vingt premières minutes, on se regarde dans le blanc des yeux sans que je ne parle. J’ai fait assez de psychanalyse pour savoir qu’il n’y a pas de solution pour activer cette case qui manque dans mon cerveau. Je suis venue pour jouer, pour elle aussi la manger des yeux, observer ses gestes, ses souffles, comprendre son fonctionnement. Au bout d’une longue aphasie, où elle me semble devenir nerveuse. Non que je le ressente émotionnellement, mais en observant les veines de ses mains se gonfler en serrant son bloc-note, je sais, que je la mets mal à l’aise. Son visage se tend lui aussi. Son menton est plus prononcé, presque en galoche. C’est le mouvement des lèvres qui produit cet effet. Elle racle sa gorge et se repositionne sur son fauteuil pour retrouver un confort qui vient de lui être enlevé. J’attends patiemment que ses yeux croisent les miens, ce qu’elle va finir par faire, pour trouver dans ma figure, un pli qu’elle pourrait exploiter pour se rassurer. J’attends encore, avant de faire mûrir sur ma bouche, les premiers mots de mon histoire, de celle que je compte lui raconter. Elle aussi voudrait dire quelque chose ressemblant à une question du genre “est-ce que vous pouvez me parler de votre famille.” Si je continue à exploiter son excitabilité, elle risque de me mettre à jour. Je commence donc à m’exprimer.
Je dis des choses sur ma relation compliquée avec mon père, et ce lien si étroit qui nous unit. Je lui parle de frayeurs nocturnes que je ne connaîtrai jamais. Je déblatère sur une frustration qui me dévore, celle d’une femme délaissée par son mari. Si elle savait que ce panel de sentiments ne se rapproche en rien des miens, mais que j’ai emprunté ces babillages émotionnels à mes congénères, elle tressauterait sur son petit siège… Elle ponctue alors mes confessions d’onomatopées gutturales, des “hein hein”, des “Mhmm”. Mais quand la petite horloge posée sur un buffet quelconque se met à carillonner, sa carcasse s’enfonce dans les coussins de son fauteuil, soulagée que la fin de la séance s’annonce. Je prends quelques secondes avant de me lever et de fermer sa petite porte.
Je m’avance dans le salon de réception. Je suis derrière une de ces colonnes. Un homme passe devant moi, sans me voir. Il est à l’affût de quelque chose. Dans ses doigts, il tient une mèche de cheveux. Plus à l’est de ma position, une femme sort un miroir et se regarde inlassablement, comme cherchant à comprendre pourquoi elle ne se reconnait plus.
Un cri ronge l’atmosphère, la déchire. « UN HÔTEL DE PASSE, OUI MADAME ! MAIS QUELLE HONTE TOUT DE MÊME ! QUOI ? VOUS NE POUVEZ RIEN FAIRE ?! » se trémousse un être décharné de type masculin que rien ne différencie vraiment d’une masse blanche de peau tombante. Tous les gens ne m’intéressent pas. Et lui fait partie du lot. Mais sa nervosité me happe. Je marche lentement pour me rapprocher de son aigreur et je flotte dans la pièce.
— C’est une pute, il n’y a pas d’autres mots pour le dire, la donzelle de la chambre 404. Elle est constamment dévêtue, se trimballe avec une chemisette de nuit en soie et attire une clientèle qui paie pour ses services.
— Monsieur, nous ne pouvons rien faire. Les invités sont libres ici. C’est bien la particularité de cette maison, répond l’hôtesse d’accueil.
— MAIS JE VOUS DIS QUE JE L’AI VUE, NUE AVEC PLUSIEURS HOMMES. PIRE ! (il baisse d’un ton), sa porte est constamment ouverte, comme une invitation à la débauche.
— Monsieur, je vous prie de comprendre que nous avons un règlement.
— Et la poupée, vous êtes au courant de sa poupée ! Une poupée de silicone grandeur nature à son effigie, jambes écartées, quand Madame, excusez-moi du terme, a la chatte en sang et ne peut plus prodiguer de ses services ! C’EST UNE HONTE !
Une poupée, m’exclamais-je pour moi-même. Le petit bonhomme continue de s’exténuer. Je ne l’entends plus. J’interromps la conversation et demande « Pourrais-je changer de chambre. Je voudrais la 403, si elle est libre ». L’hôtesse à l’accueil ouvre son registre et, d’un coup de menton, inscrit mon nom. « La 403 est à vous ».