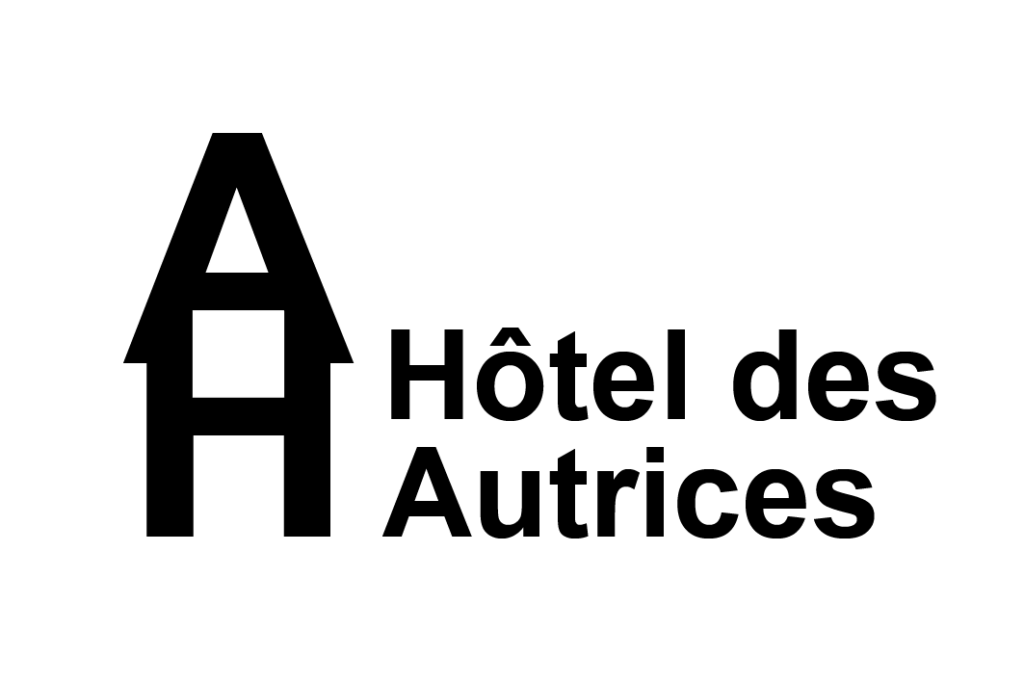Cécile Calla
2022A43
Magda. Arrivée dans la chambre 46.
Toc, toc, toc. Du fin fond de mon sommeil artificiel, j’entends quelqu’un frapper à la porte. Je mets quelques secondes à relever mes paupières. La lumière du jour s’est frayée un chemin entre les deux panneaux de rideaux aux motifs floraux verts, roses et jaunes et court jusqu’au secrétaire placé devant le lit. Ce n’est pas lui que je vois en premier, mais le cadre doré du miroir. Les feuilles de chêne qui l’ornent, me semblent familières, je me souviens d’avoir vu les mêmes motifs sculptés autour d’une nature morte dans le salon de Matka à Porthof. Au bruit qui me parvient de dehors, je me dis qu’il doit être bien tard. Les images de la journée précédente me reviennent à l’esprit : la terrible dispute avec Karl, mon départ précipité, le voyage en train dans un état second, l’arrivée dans cet hôtel, la douche et mon effroi devant ce corps, le comprimé pour oublier mon chagrin. Toc, toc, toc. Les coups se font plus insistants. Je me lève avec difficulté, enfile le peignoir gris de l’hôtel et avance d’un pas traînant vers la porte. À travers le mouchard, je reconnais la chevelure blonde du jeune réceptionniste. J’entrouvre la porte de façon à ne laisser passer que ma tête.
« Bonjour Madame, vous allez bien? Ses yeux noisette sont aussi doux que sa voix, mais ils me fixent avec insistance.
— Bonjour Monsieur, je me porte très bien.
— Nous nous inquiétions car vous n’avez pas réagi quand la femme de chambre est venue hier pour le service du soir, ensuite nous ne vous avons pas vu au dîner ni au petit-déjeuner ce matin.
— J’étais très fatiguée, j’en ai profité pour me reposer.
— Bien sûr Madame. Je voulais juste m’assurer que vous n’aviez pas besoin de quelque chose?
— Non, je souhaite juste rester au calme, je réponds d’une voix la plus détachée possible.
— Vous ne désirez pas qu’on fasse votre chambre ? Son visage clair aux traits réguliers s’est teinté d’inquiétude, les doigts de sa main droite commencent à s’agiter. C’est une très belle journée d’automne, idéale pour profiter de notre parc ou des environs, souhaitez-vous des informations sur les villages voisins ? »
Ses questions m’oppressent, ma respiration s’accélère, mes pensées s’entrechoquent : À quoi cela servirait-il ? /Rien ne me paraît plus aimable/Tout a une odeur de cendre/ Même les plus belles fleurs et les plus magnifiques maisons me semblent recouvertes de suie.
« Non ce ne sera pas nécessaire pour aujourd’hui. Pourriez-vous en revanche me faire servir un thé Earl Grey avec des tranches de pain grillé, un peu de beurre et de la confiture d’abricot?
— Avec plaisir Madame, je vais immédiatement transmettre votre demande. N’hésitez surtout pas si vous avez besoin d’autre chose. »
Je referme la porte en tremblant. Cette femme de chambre a dû leur rapporter l’incident d’hier soir. J’écarte les lourds rideaux pour laisser le soleil entrer pleinement dans la chambre. De ma fenêtre, j’aperçois les jardins du grand hôtel et la campagne environnante. Malgré l’automne bien avancé, il y a de nombreux rosiers et des massifs d’œillets d’Inde et de géraniums vivaces en fleurs. Un couple âgé marche main dans la main dans l’une des allées de la roseraie, un peu plus loin un groupe d’enfants joue à cache-cache derrière les chênes aux feuillages rougeoyants.
On frappe à nouveau. « Room service », lance une voix masculine du couloir. J’ouvre la porte, un homme de mon âge, tempes grisonnantes, longue silhouette en livrée bleu nuit me salue avec déférence. Je me contente de lui lancer un bref sourire figé, je ne veux surtout pas qu’il soit tenté de me parler. Je crois qu’il comprend, — il doit travailler ici depuis bien longtemps — d’un geste très précis et contrôlé il pousse la table roulante près de la fenêtre, verse du thé brûlant dans une tasse en porcelaine blanche, soulève le couvercle en argent en dessous duquel patientent quelques tranches de pain grillé accompagnées de beurre et de confiture, puis prend discrètement congé.
Je vais maintenant pouvoir écrire à Heinrich. Mon frère est le seul qui puisse me comprendre, je ne vois pas de toute manière à qui d’autre je pourrais m’adresser. Il a toujours été une épaule pour moi depuis notre enfance malgré nos différences de caractère. « Magda tu es trop émotive, il faut garder ton calme », me disait-il souvent lorsque je lui parlais de mes états d’âme amoureux. Lui restait imperturbable dans toutes les situations. Même l’expérience de la guerre et de la captivité n’avait pas fait bouger son socle intérieur. Il fallait être fin observateur pour déceler les fissures de son âme. Moi j’avais vu les cernes plus marqués, le regard inquiet, des gestes plus maladroits que de coutume, les lèvres fines pressées l’une contre l’autre. Je n’avais rien dit pour respecter sa pudeur. Je m’épanchais, il se contrôlait, chacun des deux y trouvait une forme de réconfort.
Dans la tête de Magda défilent les images de leur enfance à Porthof, la grande maison acquise par leurs arrières grands-parents dans les plaines du sud de Posen, les mémorables parties de chasse dans les bois alentour, les réunions de famille avec toutes les générations Wolfsmann, la fête des vendanges à la fin de l’été. Quelque chose dans ce bel établissement aux portes de Vérone lui rappelle ce passé. Peut-être les chênes du parc disposés en demi-lune, tel un groupe de vieilles dames qui se retrouvent pour l’heure du thé. Ou la roseraie qu’elle aperçoit de la fenêtre ? Avec l’aide de Papa Schulz, le vieux jardinier, sa mère avait fait planter peu après sa naissance des roses blanches et rouges devant les fenêtres de la salle à manger. Les délicats pétales étaient toute sa fierté, elle les mentionnait encore des décennies plus tard. Le pauvre Papa Schulz avait dû vivre l’exode de janvier 1945 et était décédé près de Brême il y a une quinzaine d’années. Elle pousse un long soupir, s’assoit devant le secrétaire, avale une gorgée d’Earl Grey et débute sa lettre.
Vérone, 29 mai 1965
Mon cher Heinrich,
Tu vas te dire que c’est la voix d’une morte, d’une personne dont tu ne veux sans doute plus rien savoir. Peut-être ne voudras-tu même pas ouvrir l’enveloppe quand tu y découvriras mon nom au dos. Crois-moi, il ne s’est pas écoulé une journée sans que je souffre de ce silence, de cette distance artificielle. Je savais que je pouvais y mettre fin en quelques secondes, à la vitesse à laquelle on ouvre des rideaux. Je n’en ai pas eu la force, j’ai manqué de courage, je n’ai pas osé prendre les bonnes décisions, je n’ai pas su écouter les bonnes personnes, à commencer par toi, mon frère tant aimé.
Te souviens-tu de tes mots prononcés lors de cette petite fête que j’avais donnée pour mon cinquantième anniversaire à Munich ? Tu disais qu’il faut vivre dans le vrai, que c’est la seule boussole à laquelle on doit toujours se référer. Pas juste parce que Dieu nous le commande, pas juste parce qu’il fallait tirer les leçons de ces terribles années de guerre et de la fin si amère pour notre peuple, mais tout simplement aussi pour espérer trouver un peu de calme intérieur. C’est cet apaisement qui a toujours fait défaut dans ma vie et que j’ai pourtant désespérément cherché.
Heinrich, tu as toujours été si généreux à mon égard, jamais un reproche alors que ta sœur a commis tant d’erreurs, suivi tant de mauvaises pentes. Je voyais que tu t’inquiétais quant à mes fréquentations, l’iris de tes yeux bleus se colorait de gris à mesure que je te racontais avec qui j’aimais passer mon temps. Tu m’avais même mise en garde —c e qui était rare chez toi — quand je t’avais confié mes doutes sur Karl.
« Parfois on est plus seul dans une relation qu’en étant célibataire », m’avais-tu dit. « Aimes-tu vraiment cet homme ? » avais-tu encore demandé après que je me sois une nouvelle fois plainte de sa froideur récurrente, de sa manière de rompre subitement le dialogue avec moi.
Je n’ai pas voulu te répondre quand tu t’es étonné de la liste des invités à notre mariage, tous ces anciens responsables de l’époque de la dictature conviés à fêter nos noces comme au bon vieux temps. C’était pour moi un détail, car je voulais être enfin heureuse avec un homme à mes côtés. Peu m’importait son passé, l’essentiel était le présent. Matka, notre chère mère qui n’a jamais pu surmonter la mort de Vater, m’avait toujours dit, qu’il ne fallait pas regarder en arrière, qu’il fallait saisir les mains tendues, être reconnaissante des cadeaux du destin. J’étais prête à quitter l’Allemagne, à m’éloigner de vous tous pour accomplir ma vie de femme et d’épouse. Je savais que je n’aurais plus d’enfant, je voulais au moins avoir un mariage heureux. Et la vie avec Karl dans le Tyrol du Sud me semblait prometteuse. Tout le monde y parle l’allemand et se montre très accueillant avec ceux qui viennent du Reich, les villes de Bozen et Meran te donnent l’impression de retrouver l’Allemagne d’avant les bombardements, un vrai réconfort pour quelqu’un comme moi qui a assisté à la destruction de Berlin. Alors j’ai pensé qu’il était mieux de couper le fil avec vous. Au moins pour un temps. Pour donner une chance à ce mariage, à cette nouvelle vie. D’autant que tu m’avais fait comprendre que tu n’appréciais pas Karl. J’ai saisi l’occasion de mon déménagement de Düsseldorf à Bozen pour me faire oublier. Je ne voulais pas rompre les liens, juste laisser le temps faire son œuvre, aplanir les rugosités créées par mon couple avec Karl. Sache que j’ai pensé à toi chaque jour, que j’ai souffert de ne plus entendre ta voix et celle d’Alice. Tout cela pour quoi ? Le bonheur de notre union aura été bien éphémère. Dès les premières semaines, mon horizon s’est assombri. Il passait le plus clair de son temps à organiser l’accueil et l’hébergement de ses anciens camarades dans la région et ne faisait que de brèves apparitions durant la journée. Même le soir, il avait toujours des affaires urgentes à traiter, « c’est confidentiel », me rétorquait-il quand je lui en demandais la raison. La plupart du temps, mes questions et mes plaintes étaient reçues d’un ton sec et froid ce qui ne faisait qu’aggraver ma tristesse. Je passais mes journées presque entièrement seule, sauf quand j’allais faire des courses au centre-ville. Je tournais en rond dans l’appartement, incapable de lire, d’écrire ou de faire la cuisine. Même la vue splendide sur la petite chapelle et les vignobles autour ne me procurait aucun plaisir. Une première grave dispute a éclaté un matin lorsqu’il s’est aperçu que j’avais fait enlever le grand miroir du salon et l’autre ovale du vestibule. Voir le reflet de ma solitude et de mon désespoir qui me faisait paraître encore plus usée m’était devenu insupportable. Les glaces lui venaient de sa grand-mère paternelle, l’un des rares objets de sa famille à avoir survécu à l’hyperinflation de 1923, elles étaient pour lui —ce que j’ignorais— aussi sacrées que des reliques. J’avais beau m’excuser, ma faute était irréparable à ses yeux. La dureté de ses mots et de son visage me transpercèrent l’âme comme des milliers de flèches. Cette violente altercation ne fut que la première d’un long chapelet de souffrances. Hier, c’est un oubli de ma part qui a provoqué un ultime incendie. Depuis plusieurs mois, je ne peux presque plus dormir sans aide. Cela me rend parfois distraite en journée, et c’est ainsi que j’ai oublié d’aller déposer un important courrier de Karl à la poste. C’était une lettre de décharge pour l’un de ses anciens camarades destinée au procureur de Francfort, ce qu’il ne m’avait pas dit. Lorsqu’il a vu que l’enveloppe n’avait pas quitté le petit meuble du vestibule, il est devenu fou de colère, m’accusant de tous les maux et de tous les défauts. Pour une fois, je ne me suis pas réfugiée uniquement dans mes larmes, j’ai répondu à sa fureur, les petites humiliations et agressions qu’il m’avait administrées pendant tous ces longs mois sont sorties d’un seul jet, une éruption de haine, mon corps est devenu une bête sauvage, détruisant tout sur son passage, tous les bibelots, photos, peintures ont été jetés à terre et piétinés. « Espèce de folle », a-t-il eu juste le cran de hurler avant de quitter l’appartement.
Voilà, tu sais tout, mon cher frère, tu connais tous les détails pitoyables de cette histoire. Je ne t’écris pas pour te mêler à cette affaire avilissante. Juste pour te dire que je n’ai plus le courage de continuer. Je suis une femme de 57 ans et je ne vois pas comment je pourrais recommencer. Je sais désormais que ma vie n’a aucune valeur et que le bonheur n’est pas pour moi. Ne sois pas triste si tu lis cette lettre et réjouis-toi de toutes les belles heures que nous avons vécues ensemble.
Ta fidèle sœur Magda.