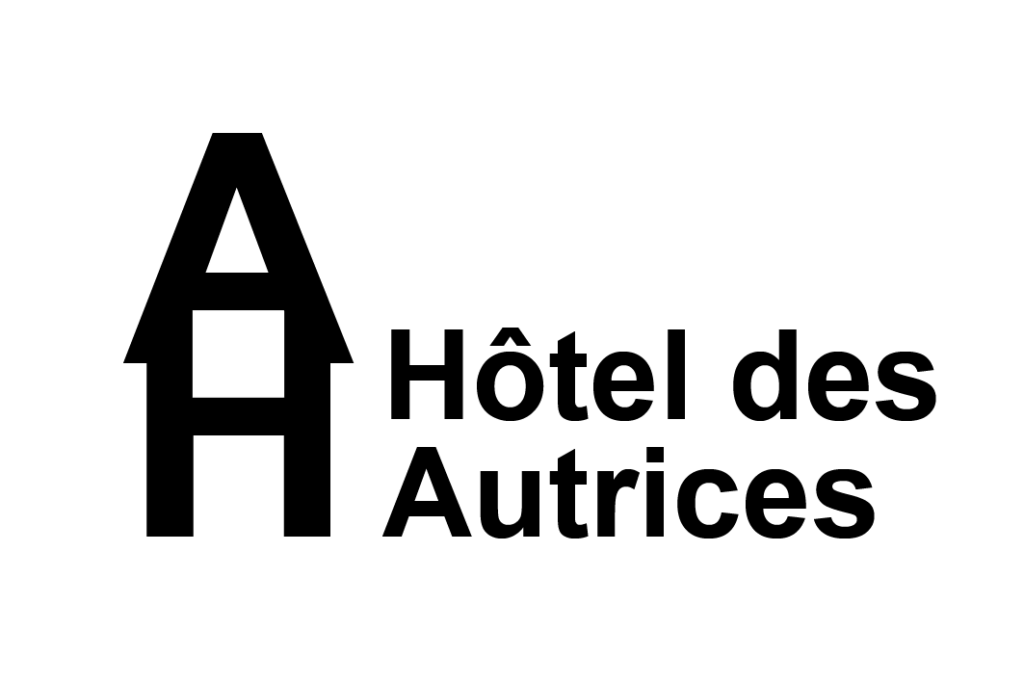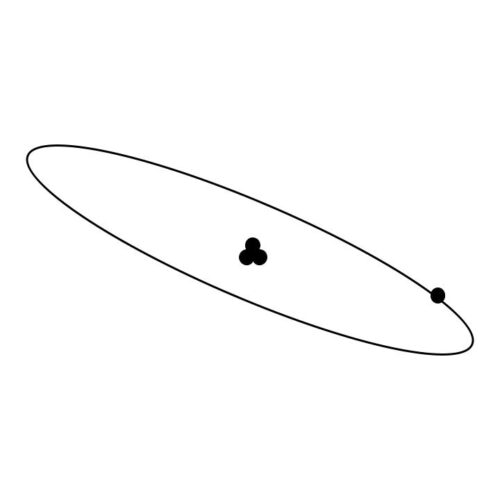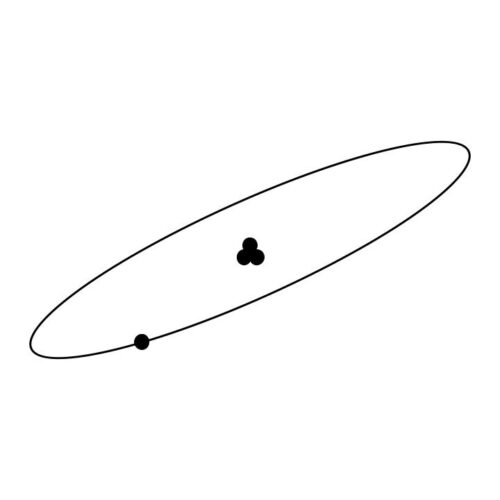Salut ma chère Sarah-Louise,
Je tente, le plus prolixement du monde, de répondre à tes questions.
S-L P-M : Est-ce que j’écris toujours au même moment et dans un même lieu?
J.M.L : Quand je rédigeais ma maîtrise et ma thèse, j’écrivais toujours dans mon bureau, sur une énorme table (une table de bibliothèque, que j’avais récupérée dans les poubelles du cégep Ahuntsic, et qui pouvait accueillir quatre personnes!), l’après-midi et le soir (je me levais très tard dans la journée, bossais jusqu’au retour de l’école des gamins et m’y remettais, vers 20h00, dès qu’ils étaient couchés) … jusqu’à minuit. Ensuite, je me tapais deux films (je faisais une thèse en cinéma)… et me pieutais vers 3h ou 4h du matin.
Aujourd’hui, c’est un peu différent.
Je n’oserais pas dire que j’écris le matin. Je suis incapable de faire quoi que ce soit le matin. La lumière du matin m’agresse. Je déteste les matins. Je suis insomniaque. J’ai du mal à m’endormir avant 2h00 AM et à être fonctionnel avant midi – héritage des études supérieures! En somme, dès mon réveil – et seulement si j’ai bien dormi (c’est-à-dire si j’ai entre 9h00 et 10h00 de sommeil ; en deçà, j’ai le cerveau comme un raisin sec et ne puis rien faire) –, je déjeune, et hop!, au boulot. J’écris au moins deux heures en ligne. Ensuite, je dîne. Puis, je m’offre un autre deux heures. Je tente une activité physique (marche, vélo) pour m’oxygéner un peu les neurones. Et je me farcis, le plus souvent possible un troisième « round ».
Quand je n’ai pas la force de m’embarquer dans un 3e ou un 2e round, eh b’en, j’en profite pour lire (La Grammaire, Montaigne, Albert Cohen…)… et quand je n’ai plus la force pour lire, je regarde un film… et si je n’ai pas la force de regarder un film, j’écoute des vinyles.
Ça, c’est durant mes trois mois de « vacances » l’été.
Sinon, pendant la session, c’est plus difficile. Surtout quand on enseigne cinq matières différentes dans autant d’institutions et que l’on passe en moyenne 3 heures par jour dans les transports en commun (où j’en profite tout de même pour lire comme un déchaîné). Cependant, j’ai réussi, exceptionnellement, cette session – entre le début de session et la mi-session (parce qu’entre la mi-session et la fin de session, les corrections s’accumulent) – à écrire un petit paragraphe par jour avant d’aller enseigner (car je n’enseigne que l’après-midi, because insomnie) pendant plus d’un mois, ce qui m’a tout de même permis d’écrire un chapitre!
Quant au lieu, j’ai pris l’habitude d’écrire sur mon balcon. Sinon, je m’enfonce dans mon sofa, l’ordi sur un coussin. J’écris rarement ailleurs que chez moi. Mais il m’est arrivé – surtout quand je piétinais… quand j’avais l’impression de ne pas avancer… de faire du surplace – de me trouver un petit café tranquille, comme la Cote R, par exemple, anciennement sis sur Ontario, non loin d’ici, malheureusement fermé depuis la pandémie. Travailler ailleurs m’empêchait de procrastiner et m’« obligeait » à me concentrer.
S-L P-M : Qu’est-ce qui favorise ou inhibe l’écriture chez toi?
JML : Je me suis trop longtemps trouvé des excuses pour être, aujourd’hui, inhibé. Quand j’aurai le temps… quand j’aurai de l’argent… quand j’aurai une maison… quand je serai seul… Il arrive un moment où tu te rends compte que ce sont des excuses plutôt poches. Je m’en suis rendu compte très tard dans ma vie, quand j’ai dû produire ma première critique de film. Je tournais en rond, repoussais le moment, remettais à demain, jusqu’au jour où je n’avais que 30 minutes devant moi avant de partir retrouver quelqu’un et que je me suis dit : « 30 minutes…! C’est b’en en masse pour jeter quelques idées…! » Ce que j’ai fait. Et depuis, je fonctionne ainsi. Je n’arrive plus à remettre, à repousser, à procrastiner…
Au reste, je ne crois absolument pas à la « page blanche ». C’est la pire connerie qu’on ait inventée pour justifier sa paresse… ou son manque de talent. Pour ma part, je répète (comme l’autre) qu’on ne choisit pas son sujet ; c’est le sujet qui nous choisit. Il nous habite. Il nous hante. Nous taraude. Nous turlupine. Et puis… à un moment… c’est trop fort… « il faut » (comme disait Nietzsche) que ça sorte. Le sujet est toujours-déjà là (ou il n’y est pas du tout – auquel cas : pourquoi écrire?).
L’autre mythe – complètement débile – est celui de l’« inspiration ». Oh my God! Pathétique! Autre aveu de paresse ou de manque de talent. Comme je le répète souvent (dans une autre de mes péremptoires antimétaboles) : ce n’est pas de l’inspiration que naît le travail, mais du travail que naît l’inspiration. Ou, comme le faisait dire Balzac à Frenhofer dans le Chef d’œuvre absolu (je paraphrase) : « Les peintres ne doivent penser que les pinceaux à la main. » Autrement dit : le sujet s’est emparé de toi – tu t’assois – tu écris. Point barre. Pas de… « Un jour, quand j’aurai le temps, je ferai une grande œuvre… » BEURK!
Bref, rien ne « favorise » ou « inhibe » l’écriture chez moi. Il y a le sujet qui me hante et, dès que j’en ai le temps, j’écris. Tout le reste n’est que pathétique excuse.
S-L P-M : Est-ce que je travaille sur différents projets en même temps?
J.M.L. : Excellente question. Un soir, j’ai rencontré une fille que je ne connaissais pas. Elle m’avait invité chez elle. Et nous avons longuement parlé. Cette fille m’a appris, à la fin de la soirée, qu’elle était hypomaniaque. Quand je l’ai questionnée pour en apprendre un peu plus sur cette drôle de « maladie », je me suis rendu compte que je l’étais aussi! Depuis des années…! Cet autodiagnostique a changé ma vie! Et cette fille, c’était toi!
Pas un jour où je ne repense à cette soirée! Pas un jour où je me présente (aux autres) comme un hypomaniaque. La « pédale dans l’tapis » (tu en auras une idée en écoutant – si jamais tu as le temps – le podcast auquel j’ai participé et dont tu trouveras le lien sur ma page Facebook; je me surprends y répéter l’expression plus d’une fois). Ça fait tellement du bien de le savoir… et surtout de le dire… de se présenter ainsi au monde… parce que, à force, je me suis rendu compte que ça dérangeait beaucoup de monde dans mon entourage (et notamment mes pâles collègues).
Bref, tout ça pour dire que, si je lis 2 ou 3 livres en même temps, j’écris aussi 2 ou 3 livres à la fois. Dès la fin de mes corrections (c’est-à-dire lundi prochain), je brûle de m’embarquer sur :
— Colloques (mon 3e manuscrit pour la collection de Robert Lévesque chez Boréal)
— Ma série de livres sur la narration / focalisation / ocularisation / réflexion / transgression / identification au cinéma.
— Un livre sur Pasolini (promis à Lévesque également).
— Un Dictionnaire de figures de style et/ou un Art poétique (deux ouvrages didactiques foutrement bien avancés).
S-L P-M : Est-ce que l’essai mobilise chez toi des dispositions de corps différentes que l’écriture de fiction?
J.M.L : Très intéressante question… à laquelle je ne sais trop si je répondrai correctement.
Mes essais naissent toujours d’une colère. Et surtout d’une colère liée à un sujet (ou à un domaine) que je connais bien : l’enseignement, la littérature, le cinéma, l’hypocrisie, le star-system, le human interest, etc. Y a des affaires qui me font chier… qui me causent des crises cardiaques… et je prends la plume comme on prend une arme (j’aime bien la caricature montrant Voltaire tenant une plume à la main comme une épée).
J’ai été affecté par la mort de Sollers. Il disait souvent, en montrant avec ostentation sa plume-fontaine, que c’était une « arme redoutable ». L’incipit de Femmes, comme je l’ai dit sur ma page Facebook, a cristallisé ce qui, pour moi, est le socle sur lequel devrait se construire toute œuvre (de recherche ou de fiction) : Avoir l’impression d’être le seul à remarquer quelque chose d’évident. BAM! Moteur de l’écriture.
Par contre, une fois au boulot, j’écris un essai comme si j’écrivais une fiction, c’est-à-dire en soignant le style. En fait… je ne « soigne » pas mon style… Ça sort comme ça! À l’instar de Paul Valéry, qui se disait incapable d’écrire une phrase aussi classique (et terne) que « La Marquise sortit à cinq heures. », je serais incapable d’écrire « Dans la société actuelle d’aujourd’hui, on trouve plusieurs problèmes dans le domaine de l’éducation. »
En revanche, quand j’écris de la fiction (pièces, nouvelles…), il y a, ou bien un sentiment (souvent dysphorique) qui me taraude et que j’essaie d’esthétiser – de poétiser – pour m’en débarrasser, ou bien une scène (disons) « de rue » que je trouve particulièrement prometteuse pour un développement. Un personnage de roman, disait Balzac, « c’est n’importe qui dans la rue, mais qui va jusqu’au bout de lui-même. »
J’ai envie, à ce point-ci, et comme tu m’y invites d’ailleurs, d’ajouter une question aux tiennes : Quelle est ta « technique » d’écriture?
Je me suis rendu compte que je servais toujours les deux mêmes métaphores pour décrire ce que je vivais : la métaphore du peintre (suivie de près par la métaphore du menuisier : mon père était manuel!) et la métaphore du sculpteur.
La métaphore du peintre :
Quand je me mets à l’ordi, c’est parce que mon crâne craque d’idées. Tout est déjà là. Alors je sacre des gros sploush de couleurs! C’est la couche de fond. J’adore ça. Ça déleste. Ça libère. Ça fait du bien.
Ensuite, c’est la deuxième couche. Je fais des formes. J’élague. Je précise. Je découpe. J’organise. J’orchestre. J’adore ça. C’est salutaire.
Enfin, c’est la dernière couche. Je fais la finition. Je cherche le mot juste, je soigne la cadence, le rythme, la musique (j’écris vraiment à l’oreille : un peu comme Flaubert ou Céline)… J’adore ça. C’est hypnotique… thérapeutique.
En somme, quand je « peins », tout va bien.
Et puis… quand j’ai l’impression que tout est là… que le manuscrit est « fini », c’est la métaphore du menuisier qui embarque. Chaque matin (ou, en tout cas, quand je me lève et que j’en ai la force), je relis le livre depuis le début… chaque jour depuis le début… jusqu’à ce que je bloque sur une aspérité. Et là, je m’y arrête. C’est comme si 1° Tu rabotes, varlopes, équarris… 2° Tu sables avec la grosse machine 3° Tu finis ça en ponçant à la main avec un papier de verre hyper fin.
La métaphore du sculpteur :
Je m’assois à mon ordi. Sans idée. Ou… avec une idée, mais vague. Vraiment vague. P’is je taponne. Je donne des coups. Au hasard. Mollement. Sans y croire. Péniblement. Je suis devant un gros bloc de marbre ou de granit… et je n’ai aucune idée de ce qui s’y cache (sera-ce un visage de femme, un visage d’homme… que sera-ce…?). Et, quelquefois, à force de donner des coups de ciseau, une forme apparaît, qui me donne un peu de quoi mordre, qui me permet d’avancer. Ça, c’est moins drôle.
Le problème (je l’ai nommé l’année dernière) – et je reviens encore à Balzac – c’est que je ne « visualise » pas mon sujet. Pourquoi Balzac a-t-il eu tant de facilité à écrire et à construire autant de personnages, autant d’intrigues…? C’est parce que – du moins c’est ce que je crois – il les « visualisait ».
Un jour, je bûchais sur un chapitre. Je « sculptais ». Ça n’avançait pas. Je voulais parler de ce genre de personne qui acquiert un capital de sympathie sans aucune raison et qui surfe, avec fatuité, sur leur succès factice. Mais ça n’avançait pas. Et là… je me suis dit… « Je dois trouver quelqu’un qui existe vraiment, que je déteste, et qui me servira de modèle… » Au bout d’une semaine, j’avais enfin trouvé, et le chapitre s’est écrit tout seul!
Dans mon livre, Victor et moi, par exemple, le dialogue entre « Elle » et « Lui » (et moi), sur lequel je bûchais fort, s’est écrit tout seul à partir du moment où j’ai « visualisé » le gars (un de mes anciens étudiants) et la fille (une de mes anciennes collègues) lesquels ne s’étaient pourtant jamais connus. Il me fallait simplement, pour ainsi dire, une « enveloppe corporelle » pour donner le branle au chapitre et leur faire dire mes idées. Idem dans le chapitre de l’entrevue d’embauche. Cinq personnes autour de la table. Cinq personnes qui existent vraiment, mais qui ne pourraient pas se reconnaître (sauf une). Cinq personnes qui ne se sont jamais rencontrées. Mais cinq personnes dont le « corps » m’a tout simplement permis de faire débouler la patente. Bref, il faut « visualiser ».
J’ajoute enfin que, pour « me mettre en train », non pas quand les idées ne viennent pas (elles sont toujours là, ai-je dit), mais quand l’épuisement m’empêche de me concentrer, quand la forme n’y est pas, j’ai développé un réflexe (pendant ma thèse) : écouter le Concerto pour piano n° 2 de Rachmaninov. Sérieux, je l’ai écouté en boucle jusqu’à en faire une indigestion. Chaque fois que je bloquais, je mettais ça… ça me mettait en transe… p’is ça me partait.
Le weed aussi… pris modérément… décuple mes sens et me fait voir les choses avec plus d’acuité. C’est un pas pire moteur aussi.
S-L P-M : Vois-tu l’écriture comme une perte de temps?
J.M.L. : Ah ah ah ah ah…! Absolument pas! C’est tout le reste qui est une perte de temps. Il me souvient d’avoir lu les cahiers de Rilke du temps où il était secrétaire de Rodin. Il raconte (je cite de mémoire) que Rodin attendait quelqu’un qui ne venait pas. Il faisait les cent pas dans sa cour en compagnie du poète. Puis, Rodin lui a demandé d’aller voir s’il voyait son invité arriver au bout de la rue. Le temps que Rilke revienne (avec une réponse négative), Rodin s’était déjà remis à sculpter.
Par contre, il est vrai que, quand j’écris, je m’en veux de ne pas lire, et que, quand je lis, je m’en veux de ne pas regarder un film, et que, quand je regarde un film, je m’en veux de ne pas écouter de la musique, et que, quand j’écoute de la musique, je m’en veux de ne pas écrire. C’est le problème des hypomaniaques!
S-L P-M : Te sens-tu parfois coupable d’écrire plutôt que faire d’autres tâches ou de passer du temps avec d’autres personnes ?
J.M.L. : Je vais être franc, direct, clair et concis : NON! JAMAIS! En fait, c’est radicalement l’inverse. Quand je fais le ménage, la vaisselle ou les courses, j’ai tellement l’impression de ne pas faire ce que je devrais faire. Si bien que ça m’enrage… je suis stressé… impatient… irritable… Vite qu’on en finisse et que je me remette à écrire.
Amicalement,
JM
PS : Tu vois, répondre à tes questions me « brûlait les doigts » (comme disait Montaigne). J’avais « hâte » d’y répondre. Jamais je n’ai voulu repousser le moment. Avoir le temps. L’inspiration. Bla bla bla. J’ai viré une brosse hier. J’ai dormi 4 heures cette nuit. Je surveille un examen en ce moment. Et j’en ai profité pour jeter tout ça d’un seul coup sur papier à un rythme ressemblant à celui que nous permet d’acquérir l’écriture automatique.