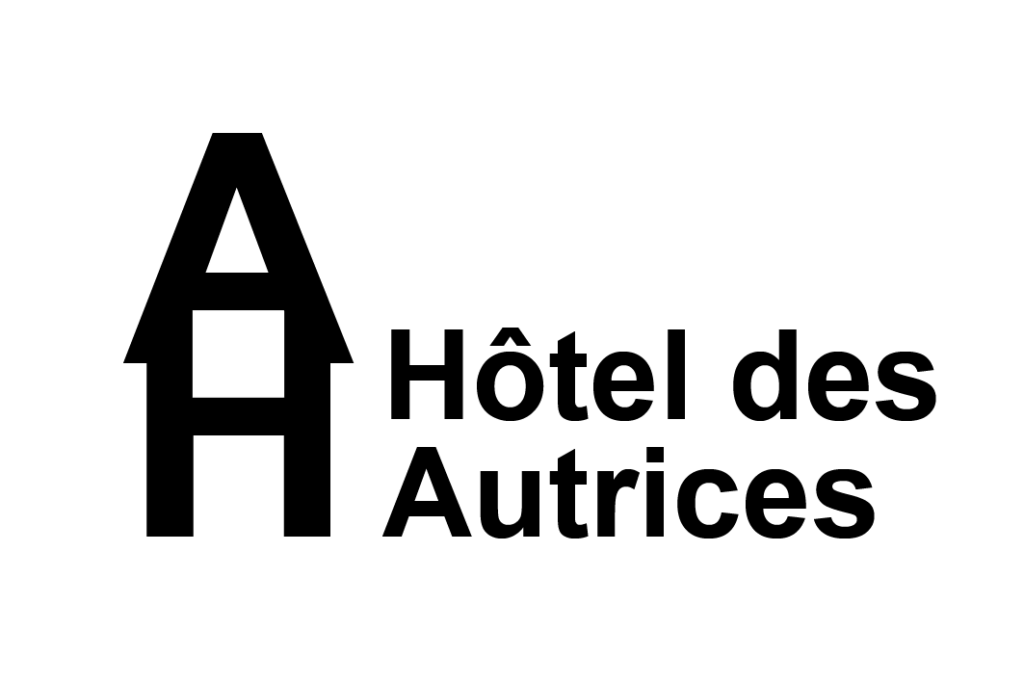Lise Villemer
2021D016
![]() Je suis en route pour l’hôtel. J’ai reçu l’invitation par e-mail quelques mois plus tôt, il s’agit d’un projet-pilote qui, si tout se passe bien, va être développé au niveau européen. Une sorte de mesure restauratrice post-pandémique. Le concept repose sur un postulat de départ simple : les couples ont été heurtés de plein fouet par la crise globale, qui s’est engouffrée dans les foyers, abolissant les frontières entre travail et intimité, faisant régresser la répartition des rôles parentaux au sein du foyer, créant des situations d’enfermement entre les quatre murs d’espaces parfois minuscules dans les grandes villes, rendant la vie commune irrespirable et suffocante, voire franchement violente. Je n’ai pas hésité. J’étais dans mon cabinet, entre deux séances, quand le mail est arrivé. J’ai ouvert la fenêtre en grand et je me suis allongée sur le matelas de fortune que je déplie parfois pour faire une sieste, et j’ai songé au bonheur que ce serait, d’explorer d’autres formes d’interactions humaines. Voir défiler les couples les uns après les autres dans une pièce neutre en instaurant un cadre de communication purement verbal me frustre parfois, sans que je sache quoi leur offrir d’autre. Lorsque le mail de relance est arrivé, avec des propositions d’hôtels concrètes et une invitation à présenter un concept d’accompagnement novateur incluant un programme de réhabilitation affective, j’ai saisi l’opportunité. Néanmoins, la fédération européenne des thérapeutes de couples a imposé une règle claire, dont le sens m’échappe encore aujourd’hui, mais qui a eu le mérite d’être validée par la sécurité sociale : les cures sont réservées aux partenaires individuellement, pas aux couples. Raisons invoquées : contourner la question de la sexualité comme enjeu central de réparation entre les couples et mettre l’accent sur la prise en charge individuelle pour régénérer et accompagner les personnes en crise, en proie au doute, quittées ou désireuses de rompre. J’ai choisi d’intervenir dans l’hôtel du bord de mer.
Je suis en route pour l’hôtel. J’ai reçu l’invitation par e-mail quelques mois plus tôt, il s’agit d’un projet-pilote qui, si tout se passe bien, va être développé au niveau européen. Une sorte de mesure restauratrice post-pandémique. Le concept repose sur un postulat de départ simple : les couples ont été heurtés de plein fouet par la crise globale, qui s’est engouffrée dans les foyers, abolissant les frontières entre travail et intimité, faisant régresser la répartition des rôles parentaux au sein du foyer, créant des situations d’enfermement entre les quatre murs d’espaces parfois minuscules dans les grandes villes, rendant la vie commune irrespirable et suffocante, voire franchement violente. Je n’ai pas hésité. J’étais dans mon cabinet, entre deux séances, quand le mail est arrivé. J’ai ouvert la fenêtre en grand et je me suis allongée sur le matelas de fortune que je déplie parfois pour faire une sieste, et j’ai songé au bonheur que ce serait, d’explorer d’autres formes d’interactions humaines. Voir défiler les couples les uns après les autres dans une pièce neutre en instaurant un cadre de communication purement verbal me frustre parfois, sans que je sache quoi leur offrir d’autre. Lorsque le mail de relance est arrivé, avec des propositions d’hôtels concrètes et une invitation à présenter un concept d’accompagnement novateur incluant un programme de réhabilitation affective, j’ai saisi l’opportunité. Néanmoins, la fédération européenne des thérapeutes de couples a imposé une règle claire, dont le sens m’échappe encore aujourd’hui, mais qui a eu le mérite d’être validée par la sécurité sociale : les cures sont réservées aux partenaires individuellement, pas aux couples. Raisons invoquées : contourner la question de la sexualité comme enjeu central de réparation entre les couples et mettre l’accent sur la prise en charge individuelle pour régénérer et accompagner les personnes en crise, en proie au doute, quittées ou désireuses de rompre. J’ai choisi d’intervenir dans l’hôtel du bord de mer.
J’ouvre la fenêtre de la voiture, joyeuse de quitter la ville, accueillant les bouffées de vent qui font voler mes cheveux dans tous les sens et glacent mes joues en ce mois d’octobre. Je pense aux longues ballades vivifiantes sur la plage, à la sensation du sable mouillé sous mes pieds nus, aux paquets d’algues collantes et aux milliers de coquillages échoués, aux fruits de mer accompagnés de vin blanc.
Ma vieille auto m’emporte vers la Côte Fleurie, et j’entends déjà les cris des mouettes, le ressac des marées, le tumulte des vagues. Je me remémore les changements de lumière spectaculaires et la saveur du poisson fraîchement pêché que ma grand-mère éviscérait sous mes yeux de ses mains noueuses lorsque j’allais passer les étés dans sa maison normande. J’ai l’impression d’avoir laissé ma vie en plan derrière moi, et le sentiment de m’en être extirpée comme une voleuse me procure une jouissance à la fois évidente et inexplicable. Les couples venant s’épancher dans mon cabinet semaine après semaine m’ont appris une chose : qui entreprend une thérapie de couple se trouve souvent déjà dans un équilibre archi précaire, au bord de l’effondrement. Du haut de leurs montagnes rocheuses, je suis à chaque fois gagnée par le besoin de me jeter avec eux et de faire durer cet instant, si intense, du saut dans le vide. Ma tâche est alors d’attraper ma lampe torche, d’ouvrir mon parachute en plein vol et de les éclairer, tout en leur tendant un filet, pour qu’ils acceptent de se regarder l’un et l’autre pendant la chute. Le vertige les plonge dans l’effroi et la panique, et leurs pieds moulinent dans les airs jusqu’à ce qu’ils trouvent le sol. Pas Henri et Jeanne, toutefois, que je n’ai pas pu sortir de l’obscurité, que le fond a engloutis et rejetés exsangues. Pas non plus Ava et Sonia, qui se sont défilées au dernier moment et reviendront sans doute dans quelque temps, si elles tiennent jusque-là. Pas non plus Jill et Sam, qui ont cru bon de rire en plein vol, à gorge déployée, défiant le danger, le narguant jusqu’à atteindre la folie d’Icare se brûlant les ailes, mais cette fois en descente piquée, pour aller s’engluer dans le goudron de leurs désirs sauvages, têtes baissées, tout rapiécés et meurtris par la cruauté de leurs rancœurs et de leurs aspirations trop longtemps ignorées. Ils réapprennent une danse fragile, vierge de leurs pas éculés, maladroits, tyranniques ou blessés. Le tourbillon de leurs valses s’imprime dans mon esprit. Je les rencontre la nuit, salue leurs mains graciles que je n’ai jamais touchées en consultation. Je fais des rêves où ils deviennent mes juges. Ils m’auscultent, je suis allongée sur le divan de leur mémoire de couple, je fais partie des couloirs de leur vie commune et ils viennent m’examiner, comme je gis là, chez eux, dans le laboratoire de leur amour. Ils m’envoient des décharges électriques et observent les réactions de mon organisme cobaye, pris au piège de leurs expériences. Ils me murmurent à l’oreille et me demandent si j’ai moi-même jamais aimé, si je suis prête à le faire, ce grand saut dans l’eau glacée ou bouillante, si je me suis déjà hissée sur le haut plongeoir de l’amour pour avancer au bord du vide et regarder le fond opaque, avant de serrer la main d’un autre dont je sais bien que j’ignore peut-être tout, en dépit de mes illusions, ou si je joue seulement à prétendre que je connais ce risque et peux les guider, tout en restant frileuse et timorée, cramponnée aux remous de la passion amoureuse comme à une serviette pour les contenir.
![]() J’accélère pour entrer sur l’autoroute. Il pleut. Je remonte la vitre. Le va-et-vient des essuie-glaces rythme mes pensées. Je me souviens d’un autre jour pluvieux où les choses ont mal tourné. Un mauvais film, me suis-je dit après avoir ouvert la porte du cabinet une fois la séance terminée, et je me suis mise à courir dans l’averse sans réfléchir, la tête pleine, des battements dans les tempes, l’esprit secoué. J’ai senti dès le départ que la femme était sur la corde raide. Son regard et sa plainte ont très vite éveillé en moi deux sentiments contraires que j’ai décidé d’accepter sans chercher à résoudre cette dualité. Elle a dit d’emblée à son partenaire : « Allez, venons-en aux faits. Tu veux lui dire ou je me lance ? » Elle avait des cheveux blonds lumineux, un visage diaphane, des cernes noirs, des yeux vert pâle. Une madone sur le point de vaciller, un ange en détresse. Je ne percevais que trop sa fragilité sous le ton péremptoire qu’elle arborait comme un bouclier, et je me sentais désarmée, envahie par le désir de la protéger. En même temps, dès qu’elle ouvrait la bouche, quelque chose me gênait et me mettait sur mes gardes, malgré moi. Son mari avait un côté beaucoup plus pataud. Nerveux, il se tortillait dans son fauteuil et avait du mal à parler. Sa phrase lui a coupé le souffle. « Bon, j’y vais alors. » Il s’est renfrogné, a acquiescé. Elle s’est alors mise à me raconter en pleurant qu’elle avait voulu aller voir ailleurs après avoir obtenu son consentement et qu’elle avait ressenti une attirance inexplicable pour une autre femme, tout en continuant à être profondément amoureuse de son mari ; qu’elle sentait pourtant qu’il lui fallait vivre cette expérience pour elle-même, en dehors de lui. Il m’a regardée d’un air implorant et, par une opération de transfusion cérébrale, j’ai senti sa douleur voyager de lui jusqu’à moi. Puis il m’a demandé de manière directe comment c’était possible, qu’elle puisse l’aimer toujours tout en le piétinant, qu’elle passe devant lui alors qu’il était en train d’agoniser et qu’elle voie de ses yeux sa souffrance et son corps tourmenté, mais qu’elle décide de l’enjamber malgré tout pour aller retrouver cette autre avec laquelle il ne pouvait même pas concourir, lui, un homme, et qu’elle continue à lui dire qu’elle l’aime encore. Comment c’est possible ? Il a répété cette question plusieurs fois, sans lâcher mon regard. Les larmes coulaient sur le visage de la femme au visage angélique. Des larmes de déchirement, de culpabilité, d’égarement. Elle a murmuré : « C’est vrai, je t’aime »… C’est à ce moment-là qu’il a sorti un couteau, de je ne sais où — d’une poche, peut-être ? Cela paraît peu vraisemblable, mais je n’ai aucun souvenir qu’il soit entré avec un sac. J’ai déjà reconstitué la scène des dizaines de fois dans mon esprit, et je me souviens qu’il est arrivé quelques minutes avant elle, les mains dans les poches. Et là, soudain, à quelques mètres de moi, tandis que je les observais et m’imprégnais de leurs paroles, j’ai vu le couteau surgir dans la paume de sa main. L’homme le serrait et me fixait du regard en tremblant : « Vous savez ce que ça fait, ça dans le ventre ?! » La jeune femme s’est affaissée dans son fauteuil en l’enjoignant de poser le couteau, il l’a ignorée et a poursuivi : « Qu’est-ce qui me retient, hein ? Elle a plus son mot à dire, elle me marche dessus, c’est ma vie, on n’a pas d’enfants… » Je me suis levée comme une automate ou plutôt, mes jambes se sont dépliées et j’ai avancé vers lui au ralenti, tout en ne pensant plus à rien, leurs corps sont devenus silhouettes, la scène se déroule en noir et blanc, je vois trouble, mes lentilles se décollent de mes yeux devenus secs, la salive reste figée au fond de ma gorge, une blouse d’infirmière invisible me recouvre de la tête aux pieds, donnez-moi ce couteau, je vais poser un garrot, arrêter le saignement, empêcher le cœur de se vider, restez calme, respirez, respirons, je ne vous connais pas en dehors de cet espace clos, nous ne sommes pas intimes, mais je vais placer ma main sur la vôtre et ce sera mon point de compression, je me relie à vous par ce toucher et vous intime l’ordre de reposer ce couteau. Il a baissé la main et m’a regardée d’un air surpris, comme s’il sortait d’une transe. Je n’ai pas prononcé un mot, à part une sorte de « chhh » comme on fait avec les bébés. Ma main sur la sienne, en apparence confiante. Au-dedans, tremblement massif. La femme s’était levée et postée à côté de moi. J’étais penchée vers l’homme, sa main dans la mienne, sans bouger, pour m’assurer qu’il reprenait ses esprits. Sans regarder la femme, j’ai senti tout son corps se raidir, en proie à une immense colère. Le séisme passé, je suis retournée m’asseoir et je comptais parler de ce qui s’était passé avant de clore la séance, mais elle ne m’en a pas laissé le temps. Elle s’est dirigée vers la sortie, s’est retournée devant la porte pour s’adresser à l’homme : « C’est trop ridicule tout ça. Toi qui refuses de voir à quel point tu es mal… comme si c’était moi l’unique cause de ton désespoir. Tu cherches toujours à me faire culpabiliser. C’est tout ce que tu veux au fond. » Il s’est redressé, a balbutié quelques excuses et est sorti à son tour.
J’accélère pour entrer sur l’autoroute. Il pleut. Je remonte la vitre. Le va-et-vient des essuie-glaces rythme mes pensées. Je me souviens d’un autre jour pluvieux où les choses ont mal tourné. Un mauvais film, me suis-je dit après avoir ouvert la porte du cabinet une fois la séance terminée, et je me suis mise à courir dans l’averse sans réfléchir, la tête pleine, des battements dans les tempes, l’esprit secoué. J’ai senti dès le départ que la femme était sur la corde raide. Son regard et sa plainte ont très vite éveillé en moi deux sentiments contraires que j’ai décidé d’accepter sans chercher à résoudre cette dualité. Elle a dit d’emblée à son partenaire : « Allez, venons-en aux faits. Tu veux lui dire ou je me lance ? » Elle avait des cheveux blonds lumineux, un visage diaphane, des cernes noirs, des yeux vert pâle. Une madone sur le point de vaciller, un ange en détresse. Je ne percevais que trop sa fragilité sous le ton péremptoire qu’elle arborait comme un bouclier, et je me sentais désarmée, envahie par le désir de la protéger. En même temps, dès qu’elle ouvrait la bouche, quelque chose me gênait et me mettait sur mes gardes, malgré moi. Son mari avait un côté beaucoup plus pataud. Nerveux, il se tortillait dans son fauteuil et avait du mal à parler. Sa phrase lui a coupé le souffle. « Bon, j’y vais alors. » Il s’est renfrogné, a acquiescé. Elle s’est alors mise à me raconter en pleurant qu’elle avait voulu aller voir ailleurs après avoir obtenu son consentement et qu’elle avait ressenti une attirance inexplicable pour une autre femme, tout en continuant à être profondément amoureuse de son mari ; qu’elle sentait pourtant qu’il lui fallait vivre cette expérience pour elle-même, en dehors de lui. Il m’a regardée d’un air implorant et, par une opération de transfusion cérébrale, j’ai senti sa douleur voyager de lui jusqu’à moi. Puis il m’a demandé de manière directe comment c’était possible, qu’elle puisse l’aimer toujours tout en le piétinant, qu’elle passe devant lui alors qu’il était en train d’agoniser et qu’elle voie de ses yeux sa souffrance et son corps tourmenté, mais qu’elle décide de l’enjamber malgré tout pour aller retrouver cette autre avec laquelle il ne pouvait même pas concourir, lui, un homme, et qu’elle continue à lui dire qu’elle l’aime encore. Comment c’est possible ? Il a répété cette question plusieurs fois, sans lâcher mon regard. Les larmes coulaient sur le visage de la femme au visage angélique. Des larmes de déchirement, de culpabilité, d’égarement. Elle a murmuré : « C’est vrai, je t’aime »… C’est à ce moment-là qu’il a sorti un couteau, de je ne sais où — d’une poche, peut-être ? Cela paraît peu vraisemblable, mais je n’ai aucun souvenir qu’il soit entré avec un sac. J’ai déjà reconstitué la scène des dizaines de fois dans mon esprit, et je me souviens qu’il est arrivé quelques minutes avant elle, les mains dans les poches. Et là, soudain, à quelques mètres de moi, tandis que je les observais et m’imprégnais de leurs paroles, j’ai vu le couteau surgir dans la paume de sa main. L’homme le serrait et me fixait du regard en tremblant : « Vous savez ce que ça fait, ça dans le ventre ?! » La jeune femme s’est affaissée dans son fauteuil en l’enjoignant de poser le couteau, il l’a ignorée et a poursuivi : « Qu’est-ce qui me retient, hein ? Elle a plus son mot à dire, elle me marche dessus, c’est ma vie, on n’a pas d’enfants… » Je me suis levée comme une automate ou plutôt, mes jambes se sont dépliées et j’ai avancé vers lui au ralenti, tout en ne pensant plus à rien, leurs corps sont devenus silhouettes, la scène se déroule en noir et blanc, je vois trouble, mes lentilles se décollent de mes yeux devenus secs, la salive reste figée au fond de ma gorge, une blouse d’infirmière invisible me recouvre de la tête aux pieds, donnez-moi ce couteau, je vais poser un garrot, arrêter le saignement, empêcher le cœur de se vider, restez calme, respirez, respirons, je ne vous connais pas en dehors de cet espace clos, nous ne sommes pas intimes, mais je vais placer ma main sur la vôtre et ce sera mon point de compression, je me relie à vous par ce toucher et vous intime l’ordre de reposer ce couteau. Il a baissé la main et m’a regardée d’un air surpris, comme s’il sortait d’une transe. Je n’ai pas prononcé un mot, à part une sorte de « chhh » comme on fait avec les bébés. Ma main sur la sienne, en apparence confiante. Au-dedans, tremblement massif. La femme s’était levée et postée à côté de moi. J’étais penchée vers l’homme, sa main dans la mienne, sans bouger, pour m’assurer qu’il reprenait ses esprits. Sans regarder la femme, j’ai senti tout son corps se raidir, en proie à une immense colère. Le séisme passé, je suis retournée m’asseoir et je comptais parler de ce qui s’était passé avant de clore la séance, mais elle ne m’en a pas laissé le temps. Elle s’est dirigée vers la sortie, s’est retournée devant la porte pour s’adresser à l’homme : « C’est trop ridicule tout ça. Toi qui refuses de voir à quel point tu es mal… comme si c’était moi l’unique cause de ton désespoir. Tu cherches toujours à me faire culpabiliser. C’est tout ce que tu veux au fond. » Il s’est redressé, a balbutié quelques excuses et est sorti à son tour.
Je fais une pause sur la route et relis mon programme pour le lendemain. J’ai prévu des activités à la plage et cette perspective m’enchante. Il est vingt heures trente lorsque j’arrive à l’hôtel. Je récupère mes clefs, signe quelques documents nécessaires pour les questions d’assurance et déambule avant de monter dans ma chambre. L’hôtel est un véritable palace, un monde fastueux recelant de lustres et de tapis orientaux, de carrelages si brillants que l’on se trouble à la vue de son propre reflet, avec un bar à cocktails aux tables vernies et aux fauteuils Chesterfield, des ascenseurs lumineux, un gigantesque escalier en colimaçon, de longs couloirs si vastes que l’on peut s’y perdre. J’entre et pose ma valise dans la chambre qui m’a été assignée au deuxième étage. C’est une pièce de taille spacieuse aux tons bleutés, avec un grand balcon donnant sur la mer. J’ouvre la porte-fenêtre et, en un instant, je sens mon cœur se soulever. Je lève les bras pour m’étirer dans un geste théâtral et éclate de rire, envahie par une joie similaire à l’excitation que je ressentais au début des vacances d’été, lorsque j’étais enfant. Je me revois à l’âge de six ou sept ans, un sac vert pomme sur le dos, laissant derrière moi mes parents qui discutaient de choses tristes ou ennuyeuses, courant sur le petit chemin qui menait à la maison de ma grand-mère. Quitter le monde du dehors et basculer dans l’univers de l’hôtel, c’est comme franchir le portail de la maison de ma grand-mère dont les portes semblaient s’ouvrir sur moi par magie, pour la rejoindre au balcon, elle qui m’attendait les bras ouverts, déjà prête à m’accueillir pour me serrer contre sa poitrine réconfortante. Je me souviens de chaque ride sur son visage, moi qui aimais suivre de mon doigt ces rigoles indélébiles lorsqu’elle venait le soir dans ma chambre pour me border dans mon lit. Chaque été, j’allais passer un mois seule avec elle et j’avais hâte que mes parents repartent. Je ne comprenais pas pourquoi ma mère et ma grand-mère s’embrassaient avec une telle froideur. Tous les mercredis après-midi, vers dix-sept heures, ma grand-mère m’emmenait dans un hôtel de luxe, sur la côte qui regorgeait d’anciennes stations balnéaires surannées. Chaque semaine, nous découvrions un hôtel différent. Ma grand-mère commandait un martini blanc et un cocktail sans alcool de mon choix et nous regardions la mer, guettant le coucher du soleil. Mon cœur se serre en repensant à ces souvenirs. Il commence à faire froid, le vent se lève. Je ferme la fenêtre et rentre dans la chambre. L’odeur de propreté me dérange, cet arrière-goût d’aseptisé me donne envie de fuir. Je décide d’aller faire un tour au bar.
Je commande un cocktail alcoolisé à base de fraise qui me rappelle celui que j’adorais boire avec elle. Dans un hôtel comme celui-ci, je me sens mieux que chez moi. Je n’ai jamais rencontré quelqu’un qui éprouve ce sentiment de familiarité si intense dans des lieux aussi transitoires et anonymes, inconnus jusqu’alors. Je bois une gorgée de cocktail dans la lumière tamisée. En reposant mon verre, je m’aperçois que mes mains ont pris quelques rides. Depuis combien de temps ne les ai-je pas regardées ainsi ? Suite à cette mission d’interprète dans un séminaire que j’avais décrochée il y a quinze ans, je ne suis jamais retournée seule dans un hôtel. C’était un établissement moderne et froid, sans âme. Je ne m’y étais pas sentie à la maison mais dans l’arène. Jugée, testée, évaluée.
Je commande un deuxième cocktail. Les murs du bar dégagent une chaleur qui inonde mes épaules, je pourrais passer la nuit recroquevillée sur un des canapés à attendre l’aube pour être la première à voir le soleil se lever depuis les grandes vitres que j’aperçois au fond de la salle du restaurant. Entendre le personnel s’activer à préparer le petit-déjeuner, savoir que je n’appartiens à personne et que je ne suis que de passage, me fait me sentir chez moi bien plus que toute autre forme d’enracinement. C’est une sensation étrange et enveloppante. Je vais cependant devoir être civilisée et aller dormir dans ma chambre, comme toute personne normale, car je dois être en forme pour inaugurer le programme qui commence demain. Ce soir, pourtant, c’est comme si une lucarne de mon enfance s’était ouverte. Ma grand-mère est assise dans un coin de la pièce, son fantôme me jauge et je bois des cocktails en son hommage. Me revoilà près de toi, dans un hôtel au bord de la mer, j’ai raté le coucher de soleil mais je sais que tu l’as admiré pour nous deux. À ta santé p’tite mère, dans cette demi-clarté tu es éternelle, je vois ton œil luire et j’ai envie de danser seule dans ce bar si peu animé. Il y a quelques personnes, pourtant, je n’y avais même pas fait attention. Je n’ai même pas remarqué que certains regards me reluquent avec curiosité. Au diable tous, je fais fi de toutes, je me contrefous de vos regards, dévisagez-moi tant que vous le souhaitez, déshabillez-moi comme bon vous semble, autant que faire se peut, vaille que vaille, à bon entendeur salut, ce soir je suis dans l’anonymat absolu. Je ris de moi-même. Je suis en autarcie, je n’ai besoin de personne, je me gausse à l’intérieur. C’est bon.