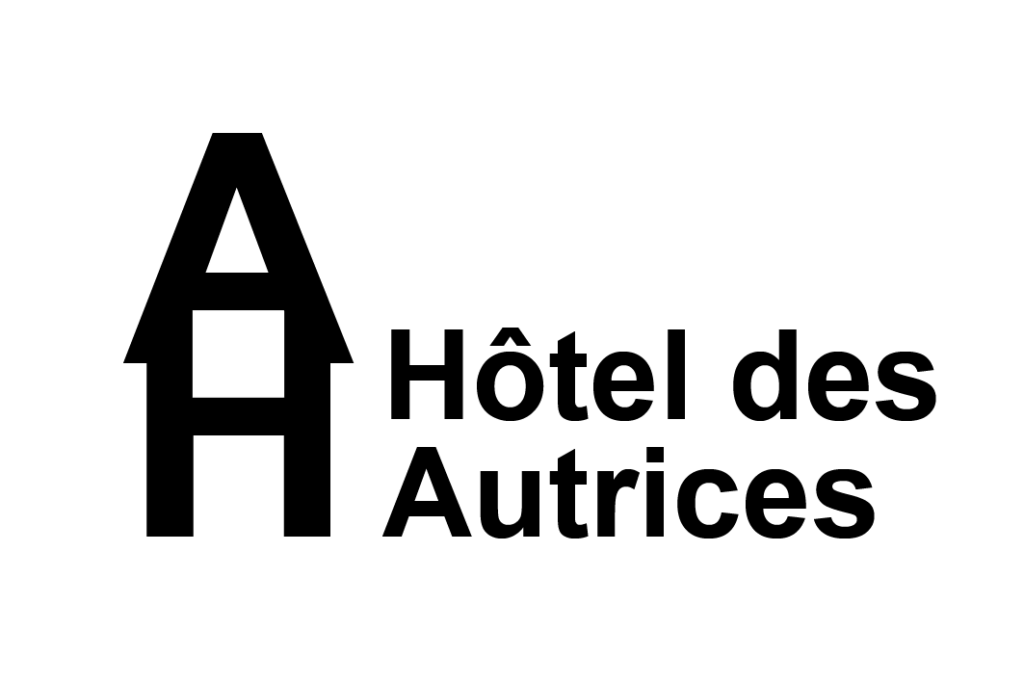Arrivée dans la chambre 44
Marylise Dumont
2020A019
Les murs sont tapissés, d’un vert un peu crasseux. J’ouvre grand la fenêtre et me penche vers la droite. J’aperçois une bicyclette sans selle, en équilibre fragile sur un balcon, au troisième étage d’une façade délabrée. En face, quelques immeubles agglutinés, confinés dans un espace en barre, privés de ciel. En me mettant sur la pointe des pieds, je vois un bout de parc, une trouée verte qui se prolonge sur quelques mètres avant d’échapper à ma vue. Il y a aussi tout un tas de véhicules insipides, deux chiens en train de jouer devant une épicerie, une pharmacie, des marronniers. Le chant d’une mésange charbonnière se mêle aux cris d’enfants qui passent, courent et s’arrêtent, puis repartent dans une course folle. Je jette de nouveau un coup d’œil sur ma droite. Dans la lumière pâle, le guidon tordu et la lampe avant du vélo semblent regarder dans ma direction. Je referme la fenêtre.
D’un geste mécanique, je tâte le matelas, le tapote de la paume de ma main, soulève les coussins et inspecte la literie, pour vérifier qu’il n’y a pas de bestioles ou de taches. Les draps me paraissent propres. J’enfouis alors mon visage dans la housse froide de l’oreiller, et le retire aussitôt. Pas d’odeur suspecte. J’enlève mes chaussures, dégrafe ma jupe et me glisse sous la couette. La nuit tombe tôt par ici. J’hésite à décrocher le téléphone de service pour commander un chocolat chaud, et me retiens. Je dois tenir jusqu’à demain, peut-être que je m’offrirai des gaufres et du vin chaud, mais pas maintenant. Je suis bien comme je suis, sans rien – tout est là, je me répète, comme une étrange ritournelle. Le haut de mon corps reste sur ses gardes, mais mes jambes se détendent. Je m’assoupis.
La sonnerie de mon téléphone me réveille. Je fouille dans mon sac, jette un coup d’œil à l’écran fissuré : Solène. Je suis presque certaine que ma sœur a contracté la maladie. Pourvu que mes parents ne l’aient pas attrapée lorsqu’ils ont ramené ma nièce et sont restés pour le déjeuner mardi dernier, juste avant qu’elle ait des symptômes. Je ne décroche pas. J’ai envie de savoir, je suis prise d’une nostalgie de la revoir, ainsi que toute ma famille et mes amis, mais l’épidémie se propage à l’allure d’un feu de forêt. Je suis paralysée. Nul ne sait par où s’enfuir. Je repense au ciel teinté de jaune sur les photos de San Francisco que le frère de mon mari nous a envoyées. L’odeur de calciné. J’essaie de me remémorer toutes les brûlures que ma peau a subies. Je me revois, petite fille, me précipiter pour rattraper à pleines mains le fer à repasser encore chaud que j’avais heurté, en chute libre : il fallait à tout prix éviter qu’il se casse. La vision de ma fille de cinq ans posant ses mains sur les plaques brûlantes pour vérifier la température, l’espace d’une seconde, curieuse du danger qu’elle pressentait sans le mesurer, se superpose à la précédente.
J’ouvre le tiroir de la commode qui se trouve près du lit pour vérifier qu’il n’y a pas de bouton égaré. J’ai une forme douce de fibulanophobie, une phobie très rare qui est apparue lorsque j’avais huit ans. Cela coïncide avec notre arrivée dans la capitale. C’est du moins ce que j’ai réussi à reconstituer, ces dernières années, en débroussaillant la lande de mes souvenirs. J’entrais en rage et me mettais à pleurer quand ma mère essayait de me faire mettre un gilet. Surtout ceux que sa mère – ma grand-mère – me tricotait pour Noël. Je revois sa boîte à couture, une vieille boîte à cigares héritée de mon grand-père, emplie de toute une collection de boutons de nacre, que j’évitais farouchement : dès qu’elle se préparait à coudre, je me débrouillais pour être ailleurs. Comme elle insistait pour m’apprendre à coudre, j’appris à mentir, et décrétai que la couture m’ennuyait. Une de mes craintes, c’était d’être immergée dans une marée de boutons. Mon corps entier, peu à peu, était cerné par le frottement des boutons les uns contre les autres, les trous minuscules, tels des yeux excavés surgis d’un monde invisible pour me dévorer, et l’infinité de motifs inconciliables. Avant de m’endormir, certains soirs, je ne pouvais résister au supplice d’imaginer chacun de mes membres ensevelis sous une vague de boutons…
Je trouve une vieille photo dans le tiroir. Je vais m’asseoir dans le fauteuil de velours, de l’autre côté du lit. Je pose machinalement la photo sur mes genoux, à l’envers. Je ne l’ai pas encore regardée. J’observe le lit à deux places. Vu d’ici, il me paraît gigantesque.
Dans mon esprit, la porte de la chambre s’ouvre sur deux silhouettes, qui entrent pour faire l’amour en hâte. Dans un film, ils se sauteraient dessus, elle serait plaquée contre un mur, dans un premier temps, puis soulevée par des mains vigoureuses. Lui, consumé de désir, la jetterait avec fièvre sur le lit. La lampe de chevet valserait. Là, dans mon film à moi, ils se serrent dans les bras, mais c’est une étreinte maladroite, toute déconcertée par l’odeur de moisi qui flotte dans l’air, la délicatesse d’un moment volé qu’ils ont du mal à saisir, la découverte d’une partie du corps de l’autre qu’ils avaient fantasmée autrement… ils doivent déployer d’énormes efforts d’imagination pour transcender cette lumière crue, pour faire suinter les murs de chaleur torride, pour oublier le grincement du matelas, pour ignorer la laideur des draps froids. Je n’arrive pas à visualiser leurs visages. Quel genre d’homme, quel genre de femme viendrait dans cette chambre d’hôtel ?
Tout à coup, je songe que l’amour n’a peut-être jamais été fait sur ce lit. Une intuition… C’est un lit vierge. Il faudrait créer des certificats de lits vierges ! Je suis venue pour me reposer : c’est exactement ce que je cherche. L’innocence rêvée. Pas de passé encombrant. Ni cicatrices ni tatouages. D’ailleurs – je scrute le plafond – aucune toile d’araignée en vue. La baignoire m’attend dans la salle de bain. J’espère que je ne serai pas réveillée par des cris d’enfants demain matin. Je n’ai pas quitté le domicile conjugal pour retrouver ce genre de bruit domestique. Aucune discordance ne doit ternir la zone blanche de ces quelques jours. Samuel m’avait encouragée à faire une pause. « Ça fait un mois que tu te traînes comme un zombie. Coupe. Tu tournes en rond là, on va pas s’en sortir ! » S’il en était arrivé là, c’est que je devais être bien enfoncée, perdue, hors-piste. Je m’étais accrochée à ses paroles comme à une bouée. J’avais attrapé un vieux guide papier, fermé les yeux et ouvert le livre au hasard. J’avais fait voyager mon index sur la page jusqu’à ce qu’il s’arrête de lui-même.
J’ai été propulsée aux abords d’une zone industrielle, dans une petite ville, au sud d’une région désertée, sans charme, autrefois réputée pour ses liqueurs et ses thermes.
Le cliché est intact. Je l’approche de mon visage. Cette odeur de vieille photo me rappelle celle des albums que j’allais sortir des étagères du cabinet en bois verni, dans la maison d’enfance de ma mère. Un monde disparu s’ouvrait à moi, et j’en savourais les récits empreints de nostalgie, les mains noueuses aux veines saillantes de ma grand-mère, et les sablés au citron et à la cannelle. Je tourne enfin la photo.
Un jeune homme est attablé entre deux jeunes femmes. Une brune à sa gauche, une blonde à sa droite, un chapeau sur la tête. Le regard perdu devant lui, il tient une cigarette à la main. Tous trois sont adossés à un immense miroir, tout proches les uns des autres. Le bras de la brune disparaît dans le dos de l’homme pour rejoindre la nuque de l’autre femme. Celle-ci a les épaules un peu voûtées sous le poids du bras de l’homme qui l’enlace, une main trapue posée sur son épaule. Une main solide, franche. La brune regarde de biais vers l’objectif, l’œil alerte et charmeur. Une mèche rebelle s’échappe de ses cheveux courts et tombe sur son front lisse. Elle est vêtue d’un débardeur rayé en tricot, qui laisse percevoir la forme de sa poitrine et exhibe ses bras nus. L’homme et la femme blonde portent une veste et une chemise blanche. Seule la cravate à rayures fines de l’homme les démarque. Le visage de la femme blonde me fait penser à des actrices de films muets. On ne voit pas ses bras. Elle n’enlace personne. L’homme brun et la femme blonde semblent résignés à leur propre épuisement, les paupières sur le point de tomber dans des brumes ouatées, communes, au terme d’une nuit étourdissante. Les vapeurs de l’alcool enveloppent leurs regards. J’aperçois un trio de verres à moitié vides, presque oubliés dans le coin de la table, tout en bas de la photo.
Ce qui me frappe soudain, c’est le visage d’un autre homme, hilare, tel un diable en boîte surgi au milieu du miroir. Lui aussi porte un chapeau, mais aux contours plus hauts, bien enfoncé sur son crâne. Rit-il pour dissimuler sa gêne devant la caméra ? Ou serait-ce pour exprimer sa fierté, son triomphe même, de voler une apparition, immortalisé d’un coup de flash qui ne lui était pas destiné ?
La femme brune, l’homme au chapeau et la femme blonde ont dansé toute la nuit.
Vers 18h30, André est passé chercher Madeleine à l’atelier de couture où elle travaille. Elle avait juste eu le temps de se changer et d’enfiler des bas dans la pièce où les modèles étaient entreposés. Comme on n’y voyait pas grand-chose, elle avait dû s’y reprendre à deux fois pour faire glisser son pied dedans sans déchirer la soie. C’était un vendredi, et comme chaque semaine depuis le début du printemps, c’était jour de bal. Sauf que cette fois, elle avait des tiraillements dans le bas du ventre et une forme de nausée, flottante depuis le réveil. Dans la matinée, elle avait failli aller vomir dans les toilettes de la petite cour derrière l’atelier, et la patronne – par chance ! – ne s’était aperçue de rien, tout occupée à réparer un bustier sur une dame élégante, une de celles qui n’ont pas une minute à perdre.
Vers 19h, bras dessus bras dessous, André et Madeleine entraient dans la salle de bal. Sur la piste de danse, Madeleine luttait pour fixer ses pensées sur l’oreille droite d’André et caressait le haut de sa nuque, d’une douceur qu’elle aimait tant, tout en fermant les yeux… Mais au bal du vendredi soir, la musique lascive ne durait jamais longtemps. Juste le temps d’un morceau. Déjà, André faisait des sauts, s’esclaffait, tournait sur lui-même, pliait les genoux, dégrafait son col de chemise, suait et exultait. Sa cravate valdinguait dans les airs. La fatigue du ferrailleur s’envolait au loin, et il ne voyait bientôt plus Madeleine. Il échangeait des regards rieurs, tout le monde se bousculait, quelques plaisanteries fusaient le temps d’avaler un verre de vin au bar, et voilà qu’il s’élançait de nouveau. Au milieu des corps déchaînés, il avait tout de suite reconnu Paulette, la cousine de Madeleine. Tournoyant, serpentant, vrillant parmi la foule d’un coin de salle à l’autre, d’un frottement de hanche ils s’étaient retrouvés dos à dos, bras contre poitrine, et ses seins avaient frôlé son buste, le temps d’une java. Les mouvements de la cousine étaient libres, ses bras nus se balançaient avec grâce, elle s’abandonnait à la griserie collective, qui était palpable dans le moindre aérosol qu’ils dispersaient à l’unisson, les innombrables gouttelettes de leur transpiration s’agglutinant dans l’atmosphère moite, électrisée, chargée de fumées de cigarettes.
L’absurdité de cette pensée me fit frissonner. J’étais toute affaissée. Je remarquai que le pied droit du fauteuil était à moitié cassé. Des pas résonnèrent du couloir, ainsi que des bribes de conversation en anglais, lancées par une voix féminine un peu essoufflée : « When will you understand, for God‘s sake, that it’s not my responsibility ?! Just go check it yourself ! »
La vibration d’un SMS venu de ma sœur : Ça y est, j’ai eu les résultats du test – c’est positif. Suis seule avec les enfants, c’est les vacances. J’ai mal partout, plus d’odorat. Je me sens comme une grosse merde. J’ai les boules qu’on nous ait pas plus protégées à l’hôpital. 7 collègues et 9 patients positifs depuis hier.
Je me lève et regarde par la fenêtre. L’arbre de la cour semble avoir perdu la moitié de ses feuilles depuis que j’ai ouvert le tiroir. J’ai chaud, il me semble que mes joues ont rosi. Je suis encore ailleurs. À l’étage du bas. Mon cœur déambule et se perd dans les vestiges de l’ancienne salle de bal de l’hôtel. Je songe à Madeleine, nauséeuse, qui hésite à reprendre un verre de vin et se ronge les sangs. Je vois Paulette et André, en sueur. Leurs corps se cherchent, se frôlent et se collent l’un à l’autre. Madeleine aura-t-elle la force de les rejoindre, pour reprendre sa place auprès de son homme, ou viendra-t-il s’asseoir près d’elle au terme d’une danse effrénée, et, sans prononcer un mot au sujet de ce rapprochement fulgurant, ils s’enivreront tous les trois, jusqu’à ce qu’un photographe du quartier appelé Brassaï, comme je le lis au dos de la photo, vienne immortaliser leurs visages à l’aube ?