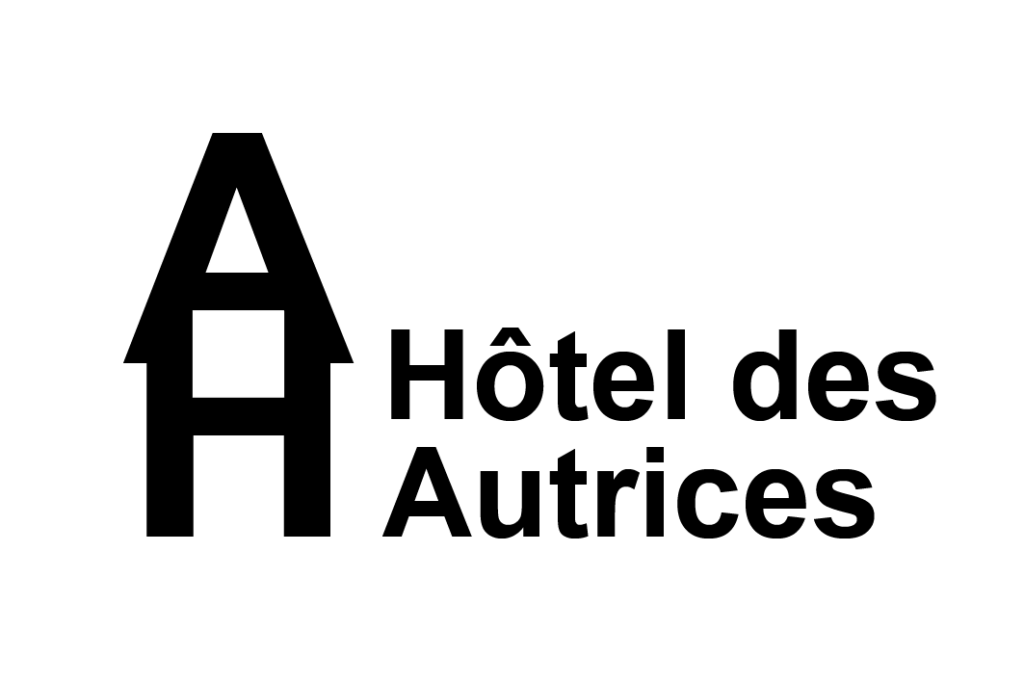Rencontre Nocturne
Marylise Dumont
2020A026
Je fus réveillée par de lointains martèlements réguliers, toc toc toc, entre les brumes de mon rêve. Cette nuit-là, ma chambre d’hôtel s’était métamorphosée en cabinet de dentiste et j’étais en train d’essayer de replier mon lit, un lit de camp basique, dans l’espoir qu’il devienne fauteuil. J’avais en tête que le pliage du lit était crucial, car il devait résister au poids d’une tablette qui allait venir s’y accoler, et celle-ci devait être à même de supporter le bras de la lampe d’examen. Je surveillais le moindre de mes gestes, me demandant comment j’allais réussir à prendre le moins de place possible, une fois le lit réduit. Je savais que tout ce chamboulement était pour un tournage, et l’impérieuse nécessité du projet ne souffrait aucune mise en question. Je devais donc disparaître de cette chambre, dont je ne reconnaissais plus que la peinture vert olive des murs. Pourtant, en dépit de ma clairvoyance, je dus déployer une énergie considérable pour mettre ce dessein à exécution.
J’étais en chemise de nuit lorsque j’ouvris la porte de ma chambre. La vue du long couloir, avec sa moquette rouge vif qui s’écoulait comme un fleuve impassible, me sortit des vapeurs du rêve. Je m’assurai d’un coup d’œil que toutes les portes des chambres étaient fermées. Toc toc toc. Les martèlements résonnaient dans le silence. Était-ce la pancarte que j’avais mal accrochée à la poignée de la porte lorsque j’étais rentrée la veille au soir, titubante de fatigue, à l’heure du couvre-feu ? Peut-être que le souffle de l’orage s’était engouffré par des fenêtres de l’hôtel restées ouvertes toute la nuit… L’hypothèse de l’écriteau ballotté par le vent fut balayée aussi vite qu’elle s’était formée dans mon esprit : « Don’t disturb » n’avait pas bougé d’un pouce. Je retournai sur mes pas et enfilai en hâte un pull mauve délavé, un pantalon noir, des chaussettes et mes bottines. J’hésitai à prendre mon manteau : allais-je oser sortir, après ce qui m’était arrivé la veille ?
J’avais brusquement quitté la trattoria de quartier dans laquelle je m’étais installée pour passer la soirée, mon deuxième verre de vin rouge à moitié vide, face à une table isolée, comme toutes les autres, séparées par un bon mètre cinquante. J’avais été saisie d’une peur irrationnelle qu’ils ferment la porte de l’Hôtel, et me condamnent ainsi à passer la nuit dehors.
Je m’étais dépêchée de franchir les portes, paniquée, perdue entre toutes ces nouvelles restrictions et ces interdits que le gouvernement ajustait sans cesse, mois après mois, sans relâche depuis plus de six mois à présent, face à un ennemi qui devenait de plus en plus résistant, et, alors que certains se repliaient dans la peur du virus ou criaient au complot généralisé, d’autres annonçaient déjà que le prochain durcissement des mesures serait combattu par un torrent de protestations, et que les foules reprendraient leurs droits, même masquées, dans la sueur et le sang. En traversant le hall, il m’avait semblé reconnaître les échos d’un air familier, dont le titre m’échappait. Je n’avais aucune envie de regagner ma chambre. Le hall était désert, les comptoirs vides. La veille, lorsque je m’étais présentée à la réception vers midi, je n’avais aperçu qu’une dizaine de noms sur le registre. Ces dix personnes étaient-elles confinées dans leurs chambres, ce soir ? À moins qu’elles n’aient noué des liens entre elles dont je ne pouvais encore percer la substance ? Soudain, à la vue des lumières tamisées, derrière les comptoirs, j’avais senti la joie m’envahir : le bar de l’hôtel n’était pas fermé.
J’avais d’abord aperçu une femme, sur la droite, à l’entrée du bar. Assise devant un piano de concert noir majestueux, son élégance rappelait un faste disparu. C’était sans doute la pianiste de l’hôtel qui jouait chaque matin l’ostinatôt (j’avais été frappée par ce mot en lisant le dépliant posé près du téléphone de service, et m’étais empressée de commander cette option : l’obstination entêtante d’une musique, tôt le matin, m’aiderait à trouver la volonté de m’extirper du lit). Elle était vêtue d’une longue robe noire et portait un turban jaune. Les yeux fermés, elle jouait et dodelinait au gré des accords. Je reconnus la sonate de Schubert que mon père passait en boucle dans la maison, lorsque j’étais adolescente. Plus d’une fois, j’avais dû me livrer à une bataille forcenée pour imposer Led Zeppelin ou The Who dans ma chambre.
L’apparition d’une petite femme brune, menue et au sourire éclatant, qui se dirigeait vers une table, tout en faisant un signe de tête au serveur derrière le bar, m’avait surprise. « Bonsoir Belloncée », avait-il lancé, en finissant par poser la main sur une bouteille de whisky qu’il avait mis du temps à trouver sur le bar. Il y avait quelque chose d’électrique dans ce geste désaccordé, et aussitôt, j’avais eu envie d’un whisky sour. Par chance, le barman n’avait rien d’un Tom Cruise à cocktails. L’expression de son visage, émacié par la faible lueur d’une bougie, la manière dont il bougeait les bras, son port de tête, tout conférait à lui donner une allure gauche et désincarnée. Comme si on l’avait transporté là pour endosser ce rôle pendant la pandémie, et pallier le manque du personnel qui était tombé malade ou avait été mis en chômage temporaire. Il devait faire une pause avant de trouver l’emplacement de chacun des ingrédients, ce qui contrastait avec l’assurance feinte qu’il arborait en les posant devant lui d’un coup sec, relevant ses manches et prenant la pose du faiseur de cocktails chevronné. Cet homme désœuvré, qui n’était nullement barman, avait dû saisir cette aubaine pour échapper à l’ennui et lutter contre la morosité d’un confinement forcé : proposer ses services de nuit dans un bar fantôme. Je m’étais surprise à imaginer la panoplie de bons soins qu’il prodiguait peut-être, en dehors de son bar au luxe décati. Je désirais que son regard se pose sur moi.
Je me tenais debout depuis de longues minutes, à l’entrée du bar, et n’avais pas prononcé un seul mot. « Bonjour », avais-je alors murmuré, avec un sourire de mise. Le barman n’avait pas réagi, mais la femme brune s’était tournée vers moi, un sillage de parfum émanant de sa chevelure, et m’avait tendu une main aux ongles laqués bleu nuit. Au dernier moment, elle s’était ravisée avec un rire complice et m’avait montré son coude. Malgré ma gêne d’entrer dans un jeu physique avec quelqu’un que je ne connaissais pas, et le ridicule de ce frottement de deux coudes qui était devenu une salutation à la mode les dernières semaines, j’avais mécaniquement répondu en approchant mon coude du sien. Mais déjà elle avait tourné les talons, et chaloupait vers le fond du bar. Simulant l’indifférence, je m’étais drapée de l’orgueil d’une femme ardemment désirée, et avais rebroussé chemin.
J’ai toujours adoré aller seule dans des bars. Était-ce le vide fantomatique d’un de ces lieux que j’avais toujours associés à un débordement de vie auparavant, qui m’avait glacée ? Des images d’une rencontre fatale, quelques mois plus tôt, me revinrent en mémoire. Ma seconde vie nocturne et mon entourage diurne s’étaient télescopés. Sans tarder, quelques rapaces avaient déployé leurs ailes. Ils s’étaient finalement liés contre moi, ces ordures, et avaient tenté de me dépecer. Plusieurs collègues avaient fait front, après des semaines de dissensions et de coups de couteaux dans le dos, une ribambelle de vacheries qui s’étaient retournées en bloc contre moi, l’une après l’autre. C’est ce qui avait mené à mon épuisement, ma brûlure interne, alias mon burnout. Avant cette nuit déplorable, j’avais réussi à embarquer deux amies dans mes sorties nocturnes, à l’abri des tempêtes extérieures. Même les soirs où aucune d’elles ne pouvait venir, je n’arrivais pas à renoncer à ces escapades. Je mentais à Samuel, car je ne voulais pas prendre le risque qu’il vienne avec moi. J’avais besoin d’être seule, mais je recherchais en fait une solitude relative, publique, presque exhibitionniste. Les premières fois où je m’étais retrouvée sans compagnie dans un bar, bien sûr, j’avais dû dépasser ce sentiment étrange et décalé d’être « une femme seule », « à cette heure tardive ». La transgression de ce geste, qui éveillait la pitié ou le désir, m’excitait. Pourtant, je me surprenais souvent à reluquer mon verre avec ennui, dans l’attente inavouée qu’une rencontre se produise. Je riais malgré moi lorsqu’un groupe s’esclaffait, rattrapée par un désir réflexe d’en faire partie. Je tapotais sur mon téléphone pour rester dans le coup et faisais mine de continuer à mener des conversations. Je sortais un carnet de notes et un livre, essayant de me convaincre que le bar n’était après tout que le prolongement de mon bureau. Je sélectionnais soigneusement les regards que j’adressais, et ceux que j’évitais. Je filtrais pour ne pas me faire emmerder. J’aspirais à être la femme seule « qui n’a pas l’air commode ». Je changeais de bar régulièrement, pour ne pas devenir une habituée et attirer d’autres piliers esseulés. Je pensais à l’amour, intact, que j’éprouvais pour Samuel. Ce manège avait duré pendant quelques semaines. Je gardais le contrôle. Je rentrais grisée, jamais très tard, et me glissais dans le lit près de Samuel. Jusqu’à cette fois où, n’ayant pu trouver le sommeil, vers trois heures du matin, je m’étais faufilée hors de l’appartement. Cette nuit-là, un collègue, misérable mais dénué de scrupule, m’avait trouvée dans un repaire de son quartier, ouvert jusqu’à l’aube. Et les choses avaient mal tourné.
Je refermai doucement la porte de ma chambre et avançai dans le couloir de l’hôtel en essayant de faire le moins de bruit possible. Les martèlements se faisaient plus intenses. J’aperçus une porte entrouverte, deux chambres plus loin. Je m’approchai, hésitante, juste assez pour passer ma tête dans l’entrebâillement : dans la pénombre, je reconnus la pianiste de la veille. Affublée d’un casque, penchée vers l’avant, ses mains semblaient dialoguer avec les touches d’un piano d’étude, d’un brun profond, qui luisait à la clarté de la lune. Elles glissaient puis bondissaient, s’élevaient pour attaquer d’autres accords, piquant, martelant, les doigts frappant les notes qui claquaient avec fièvre, toc toc toc. La musicienne se balançait d’avant en arrière, son pied droit battant discrètement la mesure. Je restai un moment figée à observer ses oscillations régulières, l’éclat diffus de sa longue robe de nuit blanche et ses mains qui s’agitaient sur le clavier ; puis je m’éclipsai sur la pointe des pieds, de peur d’interrompre ce moment sacré. Je m’engouffrai dans l’escalier plongé dans l’obscurité. Tout plutôt que de risquer l’enfermement, même en pleine lumière.
Le diagnostic de fibulanophobie émis par un psychiatre à mon encontre, l’année de mes huit ans, avait exaspéré ma mère. Nous venions d’emménager aux abords de Paris. Un éminent psychiatre avait été recommandé à mes parents, qui ne savaient plus quoi faire face à mon refus sélectif de m’habiller et mes troubles du sommeil. Ma mère s’était efforcée de ne rien laisser transparaître, mais la rage qui l’avait envahie, cet après-midi d’hiver, était flagrante. Elle fulminait en le racontant à mon père ce soir-là. Je m’étais relevée pour aller faire pipi, et les avais entendus parler de moi. Piquée par la curiosité, j’avais descendu les marches de l’escalier qui menait aux chambres dans le pavillon de banlieue, et m’étais arrêtée. J’étais restée en équilibre sur une marche, suspendue à la voix de ma mère qui répétait ce mot avec dédain. Ce mot qui, d’emblée, avait suscité mon émerveillement. Mon père essayait de la calmer. Tout va bien, j’ai confiance en elle, ce n’est pas grave, elle va s’adapter, essaie de prendre de la distance, c’est un jargon de docteur, tu sais bien qu’ils ont besoin de tout cataloguer. Mais moi, j’avais absorbé ce mot comme un philtre secret. Il était le fruit d’un diagnostic – comme le répétait ma mère avec sarcasme – qui m’était personnellement destiné, et allait m’ouvrir la porte de royaumes interdits aux adultes, dont je me promettais de garder farouchement l’entrée, jusqu’à ma mort. Déjà, j’aimais le mot funambule, depuis que j’avais fait un stage de cirque l’été précédent. Mais fibulanophobie me ravissait : c’était un mot savant, sinueux et long (toutes les voyelles sauf une et six syllabes, avais-je fièrement compté). Ma mère s’indignait contre ce médecin qui pathologisait une enfant – elle était pharmacienne et gardait contre les médecins une rancœur de principe, mêlée d’envie et d’amertume, elle à qui son père avait interdit de devenir docteur : une femme comme toi se dédie à sa famille, le métier de pharmacienne est beaucoup plus adapté à la vie de famille – et moi, je m’arrogeais la propriété absolue de ce terme. Désormais, je serais une fibulanophobe fidèle. Le lendemain, ma mère fondit en larmes lorsqu’elle découvrit que j’avais jeté dans les toilettes tous les boutons de mes manteaux et pantalons.
Durant les années qui suivirent, je compris qu’il n’était pas bien vu d’exhiber un tel diagnostic, et que j’avais le pouvoir de faire fuir ou ricaner les autres. Je m’aperçus que seules quelques élues passaient la porte de mon royaume sans frémir pour me rejoindre. Je faisais la liste de toutes les choses que je devais éviter à tout prix pour ne pas éveiller ma fibulanophobie et le racontais à mes nouvelles amies intrépides, comme un trophée : j’avais arraché les yeux en boutons d’une dizaine d’ours en peluche, j’avais fait une centaine de cauchemars dans lesquels je me retrouvais ensevelie sous une marée de boutons aux formes et aux couleurs inconciliables, et je n’avais jamais pu regarder La Guerre des boutons jusqu’au bout. Ma phobie et moi étions liées par un contrat d’exclusivité, et je me gardais bien d’en accepter une autre : c’est pourquoi, dès que je le pouvais, j’évitais de prendre l’ascenseur. Une fibulanophobie combinée à une claustrophobie n’avait plus rien de mystérieux à mes yeux. Était-ce, au fond, un geste de survie, que j’appliquais méthodiquement pour ne pas perdre tout contrôle ?
La minuterie de la lumière s’éteignit brusquement. Je m’arrêtai net, désorientée. Ma chambre était au quatrième étage de l’hôtel, et je devais être sur le point d’arriver au premier. Je descendis les marches de l’escalier plongé dans les ténèbres, en faisant attention de ne pas trébucher, éclairée par la lueur de mon Smartphone.
J’accédai enfin au rez-de-chaussée, poussai la porte qui menait à la réception, passai devant les comptoirs vides et parvins à m’engager dans le couloir principal sans être vue par le réceptionniste de veille. Je commençais à comprendre ce qui m’avait tirée du lit et me poussait à aller explorer l’hôtel en pleine nuit. Mes pas me guidaient vers l’ancienne salle de bal, qui était devenue une salle de conférence hostile. Sur le sol carrelé, je distinguai une masse sombre, recroquevillée sur elle-même. J’orientai la lampe de mon téléphone vers elle. C’était une forme humaine. Tout autour d’elle, une flaque de quelque chose. L’idée que ce puisse être de l’urine me donna envie de pleurer. Les chambres étaient à peine chauffées. On m’avait expliqué la veille que l’hôtel, déserté en ces temps de restriction, devait faire des économies. Je me souvins des récits de cette amie qui était revenue d’un long séjour à Moscou. Tous les corps de personnes mortes de froid la nuit du réveillon, que l’on retrouvait dans les rues le lendemain matin, baignant dans l’urine et la vodka. Je tâtonnai pour trouver l’interrupteur.
C’était une femme. Je m’approchai d’elle. Elle dormait, vêtue d’un imperméable et de bottes de pluie. Des mèches blondes couvraient son visage. Elle avait les bras serrés sur sa poitrine, comme pour se tenir chaud. Je posai ma main sur son bras. « Ça va ? » murmurai-je, tout en pressant son bras, pour faire bouger son épaule par petits à-coups. Je ne trouvais rien d’autre à dire. Je remarquai alors d’autres détails : ses cheveux mouillés, quelque chose qui ressemblait à un imperméable transparent, replié sous sa tête, et des bottes de pluie à ses pieds. Telle Ondine émergeant du lac, elle ouvrit les yeux et se redressa. Son regard se fixa sur moi pendant quelques secondes. Elle avait des yeux vert pâle, une peau diaphane. « Vous allez prendre froid… je vais vous accompagner dans votre chambre. » Sans que mon cerveau ait eu le temps de le décider, ma main chercha la sienne et la prit dans la mienne. Quelque chose m’émouvait profondément, et passait à travers moi. Son enveloppe humaine se lovait en moi-même, son corps semblait ne plus lui appartenir. Je sentais la douceur de sa peau, sa main de chiffe molle dans la mienne. Elle murmura qu’elle était trop fatiguée et préférait rester ici jusqu’au lever du jour. Je tentai de la maintenir éveillée en lui parlant. « Comment vous vous appelez ? Moi c’est Diane. » Je m’appelle Alice. Je vis dans une tente devant l’hôtel et personne n’a voulu de moi cette nuit, d’habitude j’arrive à finir dans une chambre mais il n’y a presque plus personne… Elle avait prononcé ces mots avec indifférence. Sa voix avait la monotonie insolite de paroles échappées d’un rêve. Je regardai autour de moi, puis agrippai mon poignet, pour m’assurer que ce n’était pas mon propre rêve qui se déroulait devant mes yeux. Je lui tendis les clefs de ma chambre, comme pour amadouer un oiseau blessé. Elle finit par les prendre. J’arrivai avec peine à l’aider à se relever. Une fois qu’elle fut debout et eut repris ses esprits, elle se mit à marcher sans peine. J’avançai à ses côtés, sur mes gardes, prête à intervenir si quelqu’un cherchait à chasser ma visiteuse. Dans le hall, je la vis se diriger vers l’ascenseur. Je n’eus pas le cœur de l’en empêcher. Elle appela l’ascenseur. Je sentis mon cœur battre jusque dans mes tempes. Moi qui avais réussi à éviter tout ascenseur depuis trente ans, sans que quiconque le repère comme problématique et m’impose d’aller « me confronter à ma peur », j’étais incapable de me soustraire à cette situation. Je savais qu’Alice devait rester hors du cercle intime des élues d’autrefois, et en même temps, je n’arrivais pas à me détacher de sa présence. Une chose étonnante se produisit alors. J’entrai dans l’ascenseur et, dès que les portes se refermèrent, je me concentrai sur les chiffres lumineux qui indiquaient les étages. Hormis quelques tensions dans la nuque et mon souffle coupé, je ne ressentis rien du tout, et sortis indemne de l’ascenseur. Alice m’avait-elle guérie ?
Je l’accompagnai jusqu’à ma chambre. Je n’avais pas d’argent, aucun bien, mon ordinateur était rangé dans mon sac, lui-même dans l’armoire fermée à clef. J’indiquai à Alice le lit, et me pelotonnai dans le fauteuil. Je détournai les yeux lorsqu’elle se déshabilla, mais j’aperçus qu’elle entrait nue dans le lit. Je comptais rester jusqu’à ce qu’elle s’endorme puis repartir pour aller explorer la salle de bal, mais j’ai dû m’endormir, car j’ai été réveillée par le son lancinant de l’ostinatôt, le corps fourbu, la nuque endolorie, et mon lit était vide. Seuls les draps défaits et, sur le sol, un foulard qui ne m’appartenait pas, me donnèrent la conviction que je n’avais pas rêvé cette apparition. J’étais bien déterminée à la retrouver.