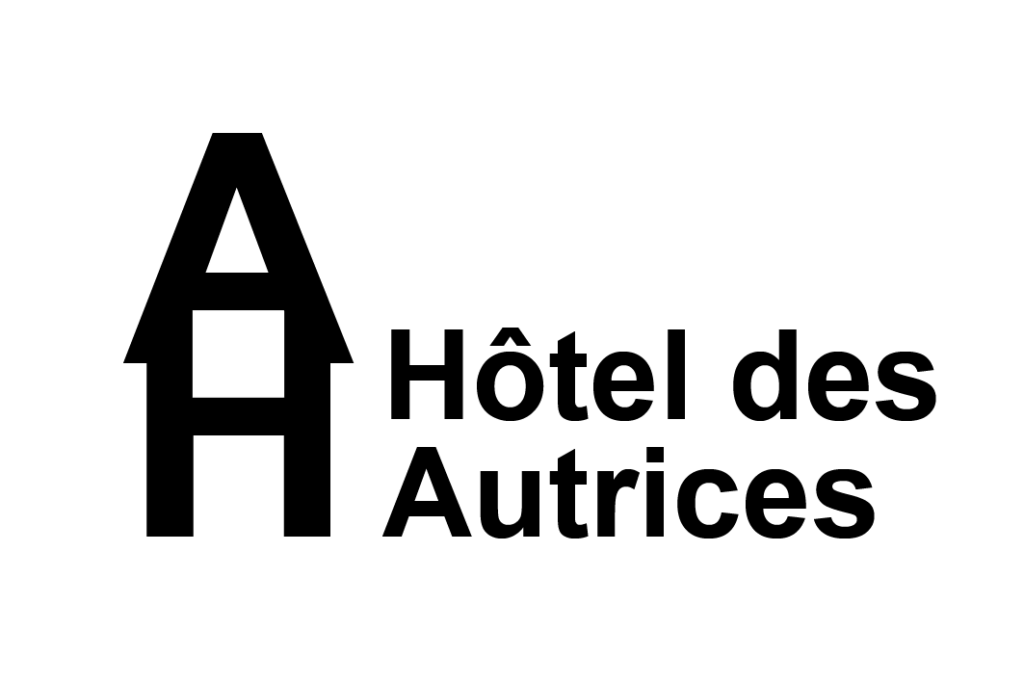Mon doigt glisse sur les pages…
Delphine de Stoutz
2020A021
Mon doigt glisse sur les pages du registre. Je glane des informations comme on cueille des violettes, une par une, en prenant soin de ne pas les déformer. 1993, 1992, 1991, 1990. L’Hôtel est un visage qui raconte son histoire. Je remonte le temps avec mon doigt à la recherche du nom de l’homme une seule fois entrevu dans la nuit des gyrophares. Je ferre son pas. La chaleur est sa chaleur et je l’attends dans le soleil frémissant de l’aurore. Sur le pont qui traverse la piscine, il me fait un geste. Je crois. Le téléphone de la réception est sûrement un code et je cherche ses pas dans les couloirs au milieu de tous ces pas et ces années avant moi. Je m’esquinte la rétine à chercher du bleu marine dans le noir et blanc des lignes. Le vent ne tombe plus, il m’emporte au gré des rumeurs. Dans le bois près du camping, son visage dans mes mains, son odeur dans les narines, j’avance.
En quelque sorte, je me dégourdis le corps avant de rendre mon cœur élastique.
J’érige un monument à cet inconnu, les monuments sont pour les vivants pas pour les morts*. Je le façonne de détails, d’un bouquet de violettes, d’expressions inventées, y mets trop de moi pour être un autre. Mon hommage ment quand il raconte son histoire. Mon monument perd l’équilibre, menace de s’effondrer, son socle est fait de vent. Les jours sans lui sont un tapis dans lequel je trébuche. Je me noie pour un fantôme.
Il avance dans ma tête, est l’objet de mes tourments. Mon corps est girouette, battu par les vents. Il est dans mon dos. Je crois que. Je me retourne, il est devant. Bleu marine de son iris collé dans ma paupière. Je ne peux plus fermer les yeux. Éclipse de lune, cataracte, cheveux noirs sur visage blanc. Il me fait un signe chaque fois que je l’oublie. Il déroule son histoire en moi. Sa voix dans ma tête, ses mots, mon lexique. Il n’a prononcé que onze phrases, 904 caractères espaces compris, une forme passive, discours indirect libre. Et puis le silence.
Il me reste à aller l’envoyer voir ailleurs qu’en moi, du moins jusqu’à ce que je sache son nom. Mon doigt glisse sur les pages, ma rétine colle au papier glacé. Trop de noir sur fond blanc. Je patine dans la nuit bleu marine. Chaque jour sans lui est un jour, où j’attends.
Je crois que je suis amoureuse.
*Frank Wedekind, L’éveil du printemps, trad. Jean-Michel Desprats, Gallimard, col.”Le manteau d’Arlequin”, 1974.