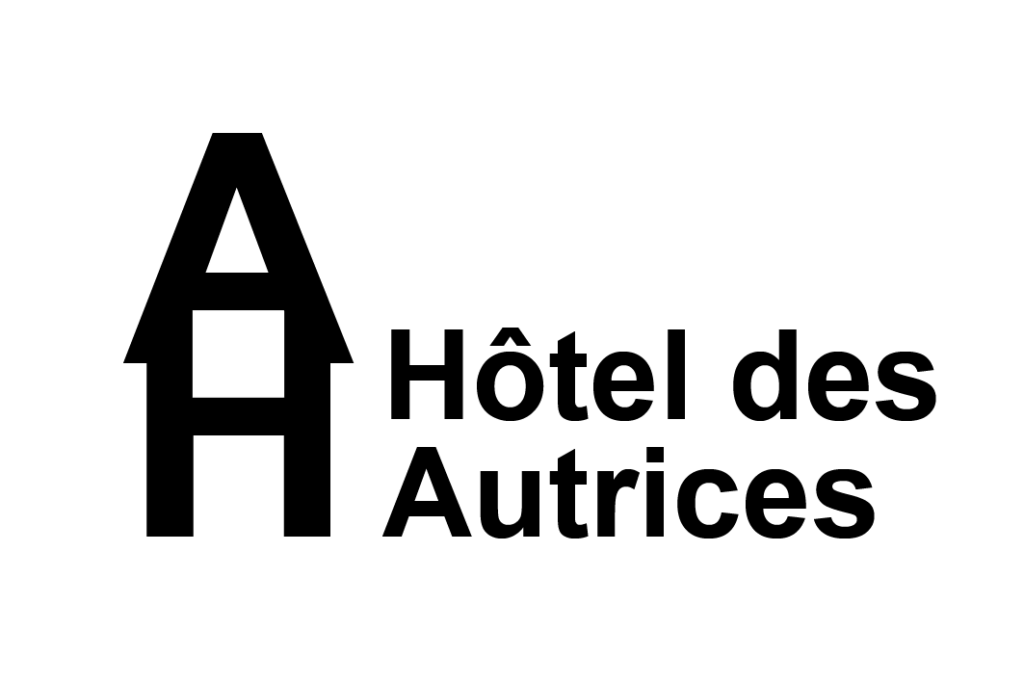Jade Samson-Kermarrec
2021A003
Il faut que je vous avoue quelque chose : j’adore dormir. Je ne fais pas partie de cette catégorie de personnes qui considèrent que dormir est une perte de temps, que dormir se réduit à un simple besoin du corps de recharger les batteries. Peut-être en aurait-il été autrement si j’avais été lève-tôt, si mon horloge interne avait été réglée sur le fuseau « l’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt », comme celle de ma mère, qui se réveille tous les jours à six heures pile, remontée comme un coucou suisse, prête à affronter la nouvelle journée qui s’annonce – plus que prête, volontaire même. J’aurais certainement vu la vie autrement, la vraie vie, avec tout ce qu’elle offre, si j’avais été lève-tôt. J’aurais pu être dans les clous, dans les horaires d’ouvertures classiques et n’aurais connu de la nuit profonde que le silence de ma propre somnolence.
Mais voilà, je suis câblée autrement.
La raison pour laquelle j’aime dormir, ce n’est pas pour son effet régénérateur. Non, si j’aime dormir, c’est pour partir, m’enfouir sous la couette, pour mieux m’enfuir. J’ai toujours beaucoup rêvé, mon inconscient est bien plus prolixe que mon conscient, ça doit être une question de censure, de voix qui paralysent, de peurs qui tétanisent.
Mon inconscient, il s’emmerde pas, il a très envie de remonter à la surface, de communiquer avec la partie émergée de l’iceberg. Alors, toutes les nuits, il prend son piolet, ses petites chaussures de rando et il s’attaque à la paroi du trou au fond duquel il patauge. Il y va pas de main morte mais il y a des jours où il fait plus dans la dentelle que d’autres. Souvent, il ne m’épargne pas, il emprunte toutes sortes de moyens d’ascension, des ascenseurs, des escaliers, des échelles, des escaliers dans des ascenseurs sur des échelles, des échelles en escaliers et vice-versa, des escalators, des colimaçons, enfin, vous voyez le genre, pas besoin de vous faire un dessin. Et puis quand c’est pas lui qui monte, c’est moi qu’il veut faire descendre, chuter, qu’on se retrouve à hauteur égale. Je résiste souvent. Même dans la chute, je ne suis pas capable de l’embrasser — sauf exception, et là, je m’envole. On voyage ensemble, côte à côte, face à face, sans se voir, comme si on était deux petits bonshommes à tourner autour de la terre, du globe, à se suivre ou se précéder, à un hémisphère d’écart, parfois moins, parfois plus mais du coup moins, ou plutôt, on ne sait plus qui poursuit qui : une course-poursuite sans fin, où réel et imaginaire s’entremêlent, s’imbriquent, s’absorbent, s’avalent jusqu’à ne plus savoir, ni où, ni comment, ni quoi.
C’est comme ça que j’ai atterri dans cette chambre d’hôtel. Je venais encore de rêver que je tombais, de ces chutes sans fin, sans fond mais qui accrochent le cœur tout en haut dans la poitrine et l’estomac dans la gorge. J’aimerais dire que je suis habituée depuis le temps que je le fais, ce rêve, ce mi-rêve, mi-cauchemar, que je le maîtrise. Je vous jure que c’est possible de maîtriser un rêve. Parfois, quand je suis en danger, que je vais mourir, je me dis « Alice, réveille-toi, c’est absurde, ce n’est qu’un rêve » et j’ouvre les yeux. Véridique. Mais avec le rêve de la chute, je n’y arrive pas, impossible. Pourtant, je le sais que cette chute est sans fin, que c’est mon tonneau des Danaïdes. Je pourrais, je ne sais pas, moi, me retourner au moins, m’asseoir confortablement sur ce sol de rien, bouquiner pendant ce temps. Quitte à tomber éternellement, autant s’en arranger, tirer le meilleur de la situation. Mais non, je continue à tomber ventre vers le sol invisible, les membres portés par la résistance de l’air à la gravité. C’est désagréable, je ne peux pas dire autrement.
Je suis encore en train de tomber — il n’y a pas de raison que ça change — quand j’ouvre enfin les yeux, dans un hoquet. Je respire fort et vite, à cause de tout cet air dans mes poumons. À bout de souffle, presque, perdue, totalement. Je bats des paupières et me redresse un peu contre mon oreiller tout écrasé par le poids de ma tête. La couette, elle, gît, mi-boule, mi-galette, malmenée par mes agitations nocturnes, ramassée dans un coin de la housse, le reste de l’enveloppe vide et froid, enroulé autour de mes pieds comme une entrave. J’essaye de dégager mes pieds, je n’y arrive pas. Je m’acharne, rien n’y fait. Je panique. Je tire sur la couette, mais comme je tire avec mes mains et mes pieds en même temps, je resserre l’étreinte. J’agite les jambes, plus vite, plus fort, les secoue en poussant des grognements, dans un mouvement de plus en plus désordonné. Je m’épuise déjà, à peine réveillée. Je finis par trouver la sortie, je libère mes pieds et balance la couette sur le sol pour triompher de ma pulsion de mort. Réveil brutal mais réponse logique à mon sommeil qui n’est qu’une longue chute.
Un peu sonnée, je regarde autour de moi, je ne reconnais rien, ni le lit, ni la chambre, ni les murs, ni la porte. Pourtant, mon sac est bien posé sur le porte-bagages à côté de l’armoire, et mes chaussures en dessous. Je me lève. Je porte mon pantalon en flanelle à carreaux rouges et noirs et mon T-shirt Kurt Cobain, celui que j’ai depuis mes seize ans, avec sa tête pleine de cheveux blonds et son crayon noir qui dégouline entre les mèches. Il est troué à mort mais pas grave, ça fait un bon pyjama. Je vais voir par la fenêtre, une fenêtre en plexiglas, avec une poignée trois positions. Je tourne la poignée à l’horizontale pour ouvrir grand la fenêtre, j’ai besoin d’air. Je constate avec étonnement que ma chambre est au rez-de-chaussée. Je ne m’attendais pas à être si proche du sol. Je passe la tête par la fenêtre, il fait frais, froid même. Un frisson me secoue, je tends quand même le cou, il fait jour, mais je n’entends rien, sauf un son, toujours le même son, comme une note qui sonne le glas. Le gla-gla — mon père, il n’aurait pas résisté à faire la blague. J’esquisse un sourire, l’image de mon père heureux de son jeu de mots me réchauffe le cœur.
Je passe des chaussettes et mets mes converses vert bouteille éventrées le long de la semelle. J’enfile même un bonnet pour couvrir mes racines grasses — je n’ai pas l’air comme ça mais je suis un peu coquette. J’ouvre la porte, décidée à tirer cette affaire au clair, peut-être que l’amnésie se dissipera à mesure que j’explorerai le lieu dans lequel je suis. En refermant la porte derrière moi, je vois dans le miroir qui lui fait face que ma chambre affiche le numéro 46. Je m’avance doucement dans le couloir qui débouche très rapidement sur une grande salle avec un piano et un comptoir. Plus de doute, je suis dans un hôtel. Je croise un homme très grand, et long, et triste. Il porte le chapeau ridicule que portent les grooms dans les albums de Tintin et les vieux films hollywoodiens. Un vestige du passé, un quasi-fantôme. Il esquisse un sourire mécanique en me croisant, poli mais absent. Il marche encore quelque pas avant de s’arrêter, et me dit, comme à retardement :
« Vous cherchez quelque chose ?
— La… la réception, balbutié-je avant d’ajouter, intimidée par ce condor déplumé, s’il vous plaît, Monsieur.
— Juste devant vous, répond-il avant de reprendre sa sinistre marche. »
Je me sens idiote, je n’aime pas demander des informations alors que la réponse se trouve juste devant mes yeux. Aveugle en plus d’être amnésique. Je fais les quelques pas qui me séparent du comptoir de la réception. Il est vide. J’appuie sur la sonnette destinée à cet effet. Le son cristallin retentit avec puissance dans le hall. En écho me revient une note aiguë, celle d’une touche de piano. Je me retourne, nerveuse. La pianiste me fixe en appuyant répétitivement sur la touche. Je n’arrive pas à lire, ni ses yeux ni sa bouche. À vrai dire, je ne sais même pas si elle me regarde ou si son regard s’est juste posé là par hasard. Nous nous faisons face un instant, étranges l’une et l’autre, étrangères l’une à l’autre.
« Stop ! Pas un pas de plus ! » me crie-t-elle en tendant le bras, la main verticale, comme une barrière.
Je ne me suis pas rendu compte que je me suis rapprochée d’elle, comme aimantée. Je bafouille, mais rien ne sort, parce que je n’ai rien à dire tout simplement. La pianiste me détaille de la tête aux pieds.
« J’aime bien ton look, cocotte ! me dit-elle avant de poursuivre, j’peux t’aider ? T’as l’air paumée…
— Il va revenir le réceptionniste ?
— Elle.
— Comment ?
— C’est elle, c’est une réceptionniste.
— Ah bon, excusez-moi. Et elle va revenir ? Enfin, vous l’avez vue aujourd’hui ?
— T’as pensé à accorder ?
— Le piano ?
— Mais non, le participe passé.
— Quoi ?
— Le participe passé. Le complément d’objet direct avant l’auxiliaire avoir. On accorde.
— Oui, oui, bien sûr.
— Le piano, c’est moi qui l’accorde.
— Et la réceptionniste ?
— Quoi, la réceptionniste ?
— Elle va revenir ?
— Peu d’chances, elle est toujours en vadrouille.
— Ah.
— Tu t’appelles comment ?
— Alice.
— Ça m’étonnerait.
— Pourquoi ?
— On a déjà une Alice pensionnaire ici, et c’est pas toi.
— Je m’appelle Alice, ça arrive que deux personnes aient le même prénom, non ?
— T’es sûre ?
— Oui.
— Certaine ? »
Je réponds « oui » en pensant « enfin, je crois ». La pianiste continue de me scruter de son regard perçant, puis finit par soulever les sourcils, quelque peu dubitative. J’ai dû perdre en intérêt, car son regard dérive de nouveau avant de se poser sur le clavier et ses doigts osseux. Tout est très long ici, me dis-je. La chute, les gens, l’attente.
Si je ne suis pas Alice, qui suis-je ?