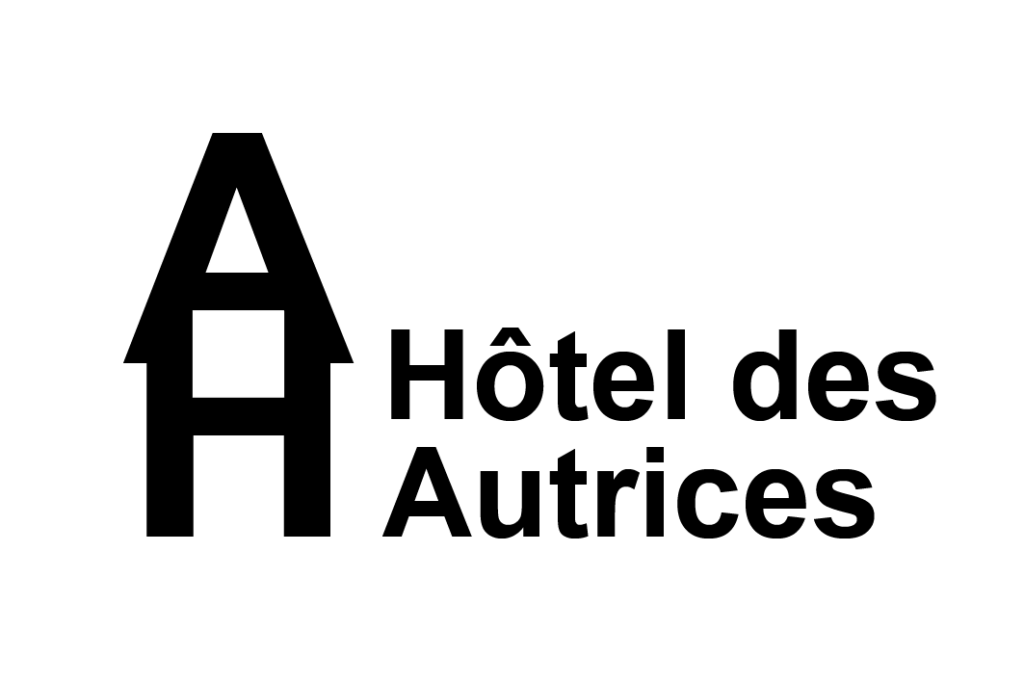Lise Villemer
2021D015
![]() Un coup de frein brusque me réveille. Le livre que je tenais entre les mains manque de tomber. Je remue mes jambes, les étends. Mes genoux sont un peu endoloris, j’ai dû m’assoupir en essayant de les garder serrés, par réflexe. Une odeur de plat cuisiné aux arômes de tomate me parvient par bouffées, je sens la faim gagner mon estomac. Je tourne la tête vers la fenêtre pour regarder les paysages aux couleurs automnales. Le train est arrêté au milieu de nulle part. Je ne sais pas où nous sommes. Au loin, j’aperçois une masse d’arbres dense et touffue, rien d’autre. Nous devons être entre deux gares, aux abords d’une forêt. La jeune femme en face de moi se racle la gorge et ajuste ses écouteurs. Pendant quelques secondes, un bruit métallique de synthétiseurs lointains résonne dans le compartiment. Pourvu qu’il ne s’agisse pas d’un incident technique et que nous ne restions bloqués ici pendant des heures. Je reconnais les vibrations de mon téléphone. L’approchant de mon oreille pour répondre, je remarque qu’il est midi trente. Mon estomac gargouille. Je suis partie aux aurores et je n’ai rien mangé. « Oui, ça va… On vient de s’arrêter. Quelque part en Belgique je crois… je me suis endormie. »
Un coup de frein brusque me réveille. Le livre que je tenais entre les mains manque de tomber. Je remue mes jambes, les étends. Mes genoux sont un peu endoloris, j’ai dû m’assoupir en essayant de les garder serrés, par réflexe. Une odeur de plat cuisiné aux arômes de tomate me parvient par bouffées, je sens la faim gagner mon estomac. Je tourne la tête vers la fenêtre pour regarder les paysages aux couleurs automnales. Le train est arrêté au milieu de nulle part. Je ne sais pas où nous sommes. Au loin, j’aperçois une masse d’arbres dense et touffue, rien d’autre. Nous devons être entre deux gares, aux abords d’une forêt. La jeune femme en face de moi se racle la gorge et ajuste ses écouteurs. Pendant quelques secondes, un bruit métallique de synthétiseurs lointains résonne dans le compartiment. Pourvu qu’il ne s’agisse pas d’un incident technique et que nous ne restions bloqués ici pendant des heures. Je reconnais les vibrations de mon téléphone. L’approchant de mon oreille pour répondre, je remarque qu’il est midi trente. Mon estomac gargouille. Je suis partie aux aurores et je n’ai rien mangé. « Oui, ça va… On vient de s’arrêter. Quelque part en Belgique je crois… je me suis endormie. »
Je sors du compartiment. Dans le couloir, j’ouvre la vitre et penche la tête vers l’extérieur. Je regarde les rails, à perte de vue. Des éclats de voix masculines me parviennent du dehors, couvrant celle de Manuel durant quelques secondes. Son débit de paroles habituel me rassure, je me dis que tout va bien, que rien de grave ne pourra nous arriver. « Moi aussi… Les filles vont bien ? » La pensée de leurs joues à la peau si fraîche, que je ne pourrai plus couvrir de bisous, me serre le cœur. Elles ont neuf et douze ans, elles débordent de cette vitalité que, depuis quelque temps, je sens tarir en moi. Je perçois le souffle tendu de Manuel. Je visualise cette légère crispation du menton que je connais si bien chez lui, signe que l’angoisse monte et mettra bientôt tout son être sous tension. J’étouffe un soupir pour ne pas déchirer le silence pesant. Je sais que cette fois, ce n’est pas la peur d’être débordé en mon absence qui est en jeu, comme cela a été le cas à chacun de mes départs en tournée. Par le passé, j’étais irremplaçable pour veiller à leurs besoins primaires, remplir leurs boîtes à goûter, organiser leurs activités de toutes sortes, et cette responsabilité indéfectible m’horripilait. À présent, plus rien en moi ne se rebelle. Je ne ressens plus une once d’agressivité. Je n’ai plus d’adversaire contre lequel lutter. Manuel est soulagé que je prenne le large, je le sais. Il aime la clarté, et notre conversation l’oppresse. Nous sommes passés dans une autre zone, sans titre de transport valide, sans embarcation réglementaire, sans bride de sécurité invisible. Je ne l’ai pas réveillé pour lui dire au revoir ce matin. Hier soir nous nous sommes serrés dans les bras, incapables de parler. Dans le lit, la peine s’étalait entre nous comme un fantôme. « Je t’appelle quand je serai arrivée. » Je raccroche sans m’étendre.
Nous avons passé tant d’heures à discuter les semaines passées que j’ai le sentiment de m’être vidée de ma sève. Je me sens dévorée de l’intérieur, le regard creusé par des cernes de fatigue mentale. Nous avons tellement parlé qu’il n’était plus pensable de faire l’amour, nos échanges étaient devenus frénétiques, un flux de paroles impossible à arrêter. Il nous fallait disséquer, chercher à comprendre, réécrire notre histoire dans les moindres détails, réemprunter les chemins autrefois visités et explorer ceux que nous n’avons pas pris, confiants, aveuglés par notre amour que nous croyions unique et plus fort que tout. J’étais prise en otage, d’une certaine façon, car c’est moi qui ai initié cet éloignement tout en souhaitant purger mon chagrin et ne surtout pas abandonner Manuel. Mais rien ne fonctionnait et nous tournions en rond. Un mur s’est érigé entre nous, en dépit de nos efforts pour ne pas nous perdre et traverser cette crise main dans la main.
« Ça sert à rien que tu restes là. J’ai besoin de distance », m’a dit Manuel il y a quelques semaines en finissant son verre de vin. Son regard semblait passer à travers moi. J’ai eu envie de courir le remercier. Il me délivrait, il nous délivrait. J’étais heureuse et brisée à la fois. Comme une enfant qui s’élance pour marcher seule tout en craignant de ne plus trouver le port d’attache tant aimé. Notre terre s’était craquelée, une fissure était apparue, la sécheresse s’était installée. J’avais peur.
Où aller ? Après avoir passé en revue amis et famille à qui je pourrais rendre visite, j’ai épluché toutes les formes de dépaysement les plus inaccessibles : trek dans l’Himalaya, jeûne et pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, randonnée avec lamas dans les Andes, camping en yourte dans le désert de Gobi, retraite de yoga sur l’île de Zanzibar, ski nautique au Portugal, équithérapie en Camargue… Bien sûr, des paysages de mers turquoise ont défilé devant mes yeux. Je me suis propulsée dans des criques paradisiaques, échouée sur le sable blanc, bercée par le clapotis des vagues, ivre de soleil. L’esprit fondant, la chair molle, basculant dans un état d’oubli de soi et de dilution absolue. Au cours de ces rêveries, j’oscillais entre une version dérisoire de ma propre nudité, infime face aux immenses vagues qui s’écrasaient sur des falaises déchiquetées, et la vision suave d’une silhouette en bikini échancré sur fond idyllique de paillotes perdues au bout du monde. Mon corps aurait suivi, je le voyais déjà se prélasser là-bas, je me trouvais en forme malgré les quelques kilos que je surveillais – confinement ou est-ce juste la quarantaine, ce confinement a bon dos. Sans aucun doute, mon corps se serait jeté à la mer avec délice. J’ai navigué de merveille en merveille sur Internet, sillonné l’Europe, failli me décider pour la Bulgarie. Je me suis couchée encore plus indécise, la tête lourde. Juste avant de m’endormir, l’envoûtement que j’avais éprouvé en regardant une publicité pour une cure thermale à la télévision il y a quelques années m’est soudain revenu. Je ne voyais plus trop de quoi il s’agissait, mais j’avais encore le souvenir précis des images de cet établissement qui était présenté comme une cure de jouvence avec cocon d’argile et bain rhassoul, où l’on voyait le personnel prodiguer soins et onguents miraculeux à des visages béats et des corps alanguis qui dans mon esprit somnolent se sont démultipliés, et j’ai vu se déployer une armée de corps féminins aux poitrines de toutes les formes imaginables, grosses, lourdes, généreuses, petites, pointues, tombantes, toniques, molles, plates, Amazones, pommes ou poires et toujours libres. Ces femmes au bord du ravissement, surgies d’un tableau de Paul Delvaux, ressemblaient à des Naïades transportées dans un ailleurs onirique et je me suis rêvée parmi elles.
Dans la salle d’attente du cabinet de ma docteure généraliste, le lendemain matin, j’étais revenue dans mon corps ordinaire et je n’avais toujours pas résolu le mystère du choix de la destination. La présence des autres individus malades ou renfrognés, eux aussi enfermés dans leurs corps de tous les jours, m’oppressait, alors j’ai fouillé dans la pile de magazines pour me distraire. C’est à ce moment-là que j’ai aperçu la brochure en papier glacé. Ce sont les lettres rouges qui ont d’abord attiré mon regard, et le titre aussi kitsch qu’un soap opera ou un slogan accrocheur : « Un hôtel pour loger votre cœur en déroute ». Un cœur était dessiné juste en dessous, façon art naïf, sur un fond couleur bleu nuit. En regardant de plus près, j’ai remarqué que le cœur était littéralement en train de se décomposer, en mille morceaux. Les infimes brisures de cœur s’entassaient et formaient un monticule de minuscules taches rouge vermeil. Au bout de quelques instants, j’ai vu qu’elles étaient reliées à une multitude de fils quasi invisibles, qui semblaient les tirer pour les emporter au-delà du ciel nocturne de l’image, dans le coin en haut à droite, vers une zone bleutée de plus en plus lumineuse. Au moment où on m’a appelée, sans réfléchir, j’ai glissé le dépliant dans mon sac.
Je suis de nouveau dans le compartiment, assise à ma place près de la fenêtre, en train de manger un sandwich. Je mâche en faisant du bruit. C’est une habitude dont j’ai honte et qui est devenue un sujet de blague entre les enfants et moi. J’arrive à m’en empêcher lorsque je me concentre, mais là, je n’en ai rien à faire, de ce que la jeune femme aux écouteurs ou le monsieur d’un certain âge bedonnant peuvent bien penser de moi. Au fond, je jubile même. Je prends plaisir à défier les conventions, comme une gamine rebelle. La docteure m’a dit que je devais ab-so-lu-ment faire une coupure et me reposer. À mon grand soulagement, mes cordes vocales étaient intactes. Pas même un micro polype. L’incident a été le premier signe que quelque chose n’allait pas. Le cauchemar tant redouté s’est produit dans la lumière crue des projecteurs, dix jours avant la première. Devant Manuel, les photographes de presse et des journalistes, les techniciens et les assistants, je n’ai pas réussi à articuler un son aigu. Ma propre voix, cette part de mon être qui m’a toujours été si fidèle, m’a crucifiée sur scène.
![]() Depuis que j’ai cinq ans, je chante. Le fil rouge de ma vie s’est toujours organisé autour de ce qui a très vite été reconnu comme un don. Toute jeune, je savais faire le vide, me concentrer sur un point fixe, élargir mes poumons, ma cage thoracique, mon diaphragme. Je créais un chemin d’ouverture à travers ma gorge comme si j’ouvrais la porte d’une cage aux oiseaux et ma voix sortait, claire et libre, infaillible. « La grâce incarnée », répétait ma mère. Elle m’a poussée depuis le début. C’est elle qui gère mon planning de représentations et m’appelle pour vérifier que je n’ai rien oublié. Même Manuel n’a rien pu faire pour l’écarter. Lui aussi, il a été pris au piège de ce filet cristallin et puissant qui jaillit hors de mes lèvres et me relie au monde. Il est tombé amoureux de ma voix. Ce sortilège me précède et m’a toujours protégée. Je me suis contentée de suivre le chemin qui m’était destiné. J’ai failli tout plaquer à 25 ans, lorsqu’un metteur en scène a insisté pour me faire chanter nue dans un spectacle. J’étais la seule interprète femme au milieu d’un chœur de chanteurs et rien ne justifiait ma nudité. Je passais des répétitions entières à me maudire de ne pas oser dire non et claquer la porte. J’ai quitté mon petit ami de l’époque qui ne comprenait rien, je me dégoûtais, vomissais toute la bile que je portais en moi chaque matin et m’effondrais le soir en refusant de manger, mais j’étais figée, telle la biche sacrifiée à l’autel de sa carrière. Finalement, grâce au soutien de ma mère, j’ai réussi à m’opposer. Fière de ma victoire, j’ai obtenu de porter une nuisette lors de toutes les représentations. Manuel, jeune metteur en scène travaillant dans des hangars obscurs, bien déterminé à se frayer un chemin hors des bas-fonds du milieu théâtral underground, est venu voir le spectacle et m’a proposé un rôle quelques jours après. Nous sommes devenus amants, en secret les premiers temps afin ne pas dévoiler notre liaison au reste de la troupe. Peu à peu, notre amour s’est déployé à ciel ouvert. Je coécrivais les spectacles avec lui et chantais. Les choses semblaient limpides. Pourtant, aujourd’hui, je ne sais plus qui, de ma mère, de Manuel ou de moi-même, a guidé ma vie.
Depuis que j’ai cinq ans, je chante. Le fil rouge de ma vie s’est toujours organisé autour de ce qui a très vite été reconnu comme un don. Toute jeune, je savais faire le vide, me concentrer sur un point fixe, élargir mes poumons, ma cage thoracique, mon diaphragme. Je créais un chemin d’ouverture à travers ma gorge comme si j’ouvrais la porte d’une cage aux oiseaux et ma voix sortait, claire et libre, infaillible. « La grâce incarnée », répétait ma mère. Elle m’a poussée depuis le début. C’est elle qui gère mon planning de représentations et m’appelle pour vérifier que je n’ai rien oublié. Même Manuel n’a rien pu faire pour l’écarter. Lui aussi, il a été pris au piège de ce filet cristallin et puissant qui jaillit hors de mes lèvres et me relie au monde. Il est tombé amoureux de ma voix. Ce sortilège me précède et m’a toujours protégée. Je me suis contentée de suivre le chemin qui m’était destiné. J’ai failli tout plaquer à 25 ans, lorsqu’un metteur en scène a insisté pour me faire chanter nue dans un spectacle. J’étais la seule interprète femme au milieu d’un chœur de chanteurs et rien ne justifiait ma nudité. Je passais des répétitions entières à me maudire de ne pas oser dire non et claquer la porte. J’ai quitté mon petit ami de l’époque qui ne comprenait rien, je me dégoûtais, vomissais toute la bile que je portais en moi chaque matin et m’effondrais le soir en refusant de manger, mais j’étais figée, telle la biche sacrifiée à l’autel de sa carrière. Finalement, grâce au soutien de ma mère, j’ai réussi à m’opposer. Fière de ma victoire, j’ai obtenu de porter une nuisette lors de toutes les représentations. Manuel, jeune metteur en scène travaillant dans des hangars obscurs, bien déterminé à se frayer un chemin hors des bas-fonds du milieu théâtral underground, est venu voir le spectacle et m’a proposé un rôle quelques jours après. Nous sommes devenus amants, en secret les premiers temps afin ne pas dévoiler notre liaison au reste de la troupe. Peu à peu, notre amour s’est déployé à ciel ouvert. Je coécrivais les spectacles avec lui et chantais. Les choses semblaient limpides. Pourtant, aujourd’hui, je ne sais plus qui, de ma mère, de Manuel ou de moi-même, a guidé ma vie.
« Regarde, c’est là que je vais aller passer dix jours », j’ai dit à Manuel le soir même. Sans regarder, il m’a demandé ce que le docteur avait dit. « C’est une femme », je lui ai répondu, sur un ton de défi qu’il n’a pas relevé. « Ah. Et alors, qu’est-ce qu’elle a dit ? » J’ai posé la brochure sur la table avec une moue de petite fille déçue, vexée de constater que son jouet tant convoité n’attire pas l’attention. Pourtant, l’objet en question n’a pas cessé de me hanter. « Elle a dit que je devais arrêter de forcer sur ma voix, tout mettre en pause. » J’ai dit cette longue phrase d’un trait, sans respirer, les yeux rivés sur les lettres rouges et le cœur bleu nuit qui grossissait et devenait de plus en plus abstrait, pour prendre l’apparence d’une tache sombre et insondable. Le temps s’est suspendu. Je me suis sentie seule, isolée dans une bulle avec le bruit de la machine à café et des dernières gouttes qui s’écrasaient une à une dans le fond de la tasse. « Mais la première est dans quinze jours, comment tu vas faire ? Elle t’a prescrit de la cortisone ? » C’est à cet instant que j’ai dû lutter de toutes mes forces pour ne pas me faire happer, lui résister, m’imposer. Je ne sais pas si c’est mon regard ou les mots que j’ai employés, mais quelque chose a sauté au visage de Manuel. J’ai expulsé, arraché de mes entrailles, catapulté dans les airs un non violent. NON. Je ne vais pas m’anesthésier à la cortisone et continuer à m’abîmer, pour servir notre projet qui est devenu ton fief. Tu vas te débrouiller. Peut-être que tu vas devoir annuler ton spectacle, oui. Non, je n’en prendrai pas la responsabilité. Lorsque je me suis tournée vers lui, j’ai vu comme une marque qui déformait son visage. Il portait l’écho de ce refus que je venais de proférer, indéniable, au milieu de la figure. J’avais enfin posé une limite claire, à bout de bras, et le non avait figé ses traits. Par effet de miroir, j’étais abasourdie comme si j’avais pris une gifle.
Après le départ de Manuel, un courant d’air glacé a envahi la cuisine. J’ai tenté de me réchauffer avec une tasse de café brûlant et me suis mise à feuilleter la brochure. Le graphisme était kitsch d’un bout à l’autre, mais les pages deux et trois m’ont paru plus sobres. Sur un fond de plage, de mer et d’écume, la chevelure rousse d’une femme, tête rejetée en arrière et peau translucide, flottait sur la double page. Pourvu de jambes sans doute retouchées pour avoir l’air brillantes et infiniment longues, son corps de sirène s’étirait comme un faisceau céleste et léger, suspendu au-dessus d’un lit spacieux qui semblait attendre de le réceptionner, dans une chambre aux tonalités pastel et apaisantes. Les pages d’après étaient consacrées à la promotion d’un séjour inédit et novateur, destiné à accueillir toutes les personnes rencontrant des déroutes affectives. J’ai parcouru le programme détaillé des activités et des conférences décrit sur plusieurs pages, mais je me suis arrêtée à la page neuf : l’amour brisé ou malheureux était représenté par une mouette à l’aile arrachée, juchée sur un roc, fixant de ses yeux jaunes un rivage à marée basse qui reflétait la lumière à l’infini, la mer et l’horizon se confondant à perte de vue.
Je me dépêche de rassembler mes affaires. Le train se vide de ses passagers, les silhouettes vont et viennent dans le couloir. Il est tard, le voyage a été long. Je suis encore en chaussettes. Après trois correspondances, mon cerveau est épuisé et j’ai du mal à fixer mes pensées pour agir de façon pratique, ou même logique. Je dois me mettre à quatre pattes pour aller récupérer mes chaussures qui ont glissé tout au fond sous la banquette. Il fait nuit lorsque je descends enfin les marches qui mènent au quai. Je suis une des dernières à sortir. La petite gare est déserte. Il est vingt et une heures. Le taxi m’amène devant l’hôtel en moins d’une heure. Sur la route, les phares des véhicules qui filent sur l’autre voie éblouissent mes yeux fatigués. Le chauffeur taciturne écoute une musique douce et mélancolique. L’excitation d’arriver dans un nouveau lieu ne suffit pas à maintenir ouvertes mes paupières lourdes.
Bien que la façade de l’hôtel n’ait pas figuré sur la brochure, je reconnais l’endroit. Le bâtiment est fidèle à l’idée que je m’étais faite d’une ancienne destination thermale. Un édifice majestueux entouré de jardins, avec vue sur la mer. Traînant ma valise pour accéder au vestibule de l’hôtel, je remarque des fissures sur le mur et aperçois la silhouette d’une femme quittant un balcon à la rambarde écaillée avant de disparaître dans sa chambre. Les portes coulissantes s’ouvrent et se referment derrière moi. Dans le hall, la lumière diffractée du lustre baroque me donne le vertige. Je m’arrête au milieu de la pièce. L’atmosphère feutrée de salon, les intonations suaves caractéristiques des réceptionnistes, les frottements de semelles sur le carrelage luisant, le tintement de trousseaux de clefs et le son lointain d’un piano résonnent jusque dans mes tempes. Je reste immobile, comme aspirée par une force irrésistible, souterraine et diffuse. L’espace d’un instant, j’ai l’impression de me vider de mon sang. Somnambule, j’avance jusqu’à la réception. Une jeune femme blonde au sourire de glace me tend une carte magnétique, ainsi qu’un badge en forme de cœur bleu nuit. « Bienvenue au congrès des cœurs souffrants », me susurre-t-elle. « Vous pourrez assister aux ateliers dès demain matin à partir de dix heures. La plupart des autres participantes et tous les participants sont déjà arrivés. »
Je suis dans ma chambre. Elle porte le numéro 44. La réceptionniste a dit que je devais prendre possession de ma chambre. J’ai failli pouffer de rire avec son histoire de cœurs souffrants. J’ai traîné mon cœur souffrant à l’hôtel comme un chien en laisse, et je vais marquer mon territoire comme un animal. Cela ne peut passer que par une forme de violence. L’appropriation passe par la destruction de tout ce qui m’est étranger. Ces deux semaines dans un hôtel seront personnelles, ou ne seront pas. Et si ce n’est pas mon sang qui risque cette fois de laisser des traces sur le matelas — joie d’être en début de cycle —, ce sera l’empreinte de mon corps, l’eau salée qui s’écoule de mes yeux, mes résidus de peaux mortes, mes songes nocturnes et mes cheveux perdus qui viendront se déposer dans la taie de mon oreiller et, par un processus de transfusion occulte, pénétreront dans le matelas, sédiments d’inconscient en attente des prochains cerveaux dormeurs. Je commence par le vase de fleurs aux tiges coupées trop court. J’attrape le bouquet et jette l’eau dans l’évier. L’odeur d’œuf pourri se répand. J’hésite puis je remplis le vase d’eau fraîche, décidant de laisser aux fleurs la vie sauve. Je me fais couler un bain.
J’aère la pièce et me penche par la fenêtre pour humer la fraîcheur du soir. La rue est calme. Aucun avion dans le ciel ; parfois, j’essaie de visualiser l’ampleur de la pollution atmosphérique pour refuser de fuir et rester consciente. Comme si mon esprit pouvait rejoindre les traînées de kérosène, condensation et radiation. Je les imagine, dangereuse triade menaçant de nous détruire, tandis que des centaines de passagères et de passagers, là-haut, assis en rang dans leur machine, noient leurs esprits anxieux dans l’alcool à volonté, mangent des crackers, parlent pour couvrir les ronflements de voisins et les pleurs de bébé, s’abrutissent devant les petits écrans. Ma tête est à hauteur du feuillage des arbres, des frissons parcourent les feuilles, la nuit est noire et deux merles chantent.
Je m’allonge dans le bain. Je m’enfonce dans l’eau et cale mes pieds sur la paroi de la baignoire. Mes fesses reposent sur la surface glissante, mes bras se relâchent, ma nuque dodeline. Ma peau se plisse et se fripe. Les fleurs dans le vase, elles aussi, se flétrissent à cette heure. Je ne sais pas ce qui m’attend, mais je ris en repensant à la tête que Céline a faite lorsque je lui ai parlé de l’hôtel et du congrès. « Une semaine de développement personnel dans un grand hôtel avec un tas d’inconnus dépressifs et des gourous juste là pour empocher ton fric et te faire des sourires mielleux jusqu’à ce que tu craches ton cœur et pleures en disant que tu vas plus pouvoir jamais tomber amoureuse de ta vie, non mais tu rigoles ? Tu vas vraiment payer pour ça ? Putain, ton mec est un metteur en scène invité à un festival hyper prisé, ça fait des années que vous fantasmez là-dessus et toi, tu te débines pour aller faire de la danse contact ou des massages avec des gens qui vont se frotter à toi pour oublier leurs peines de cœur ? T’imagines leurs gueules, leurs regards dégoulinants, leurs mains toutes nerveuses et toutes frémissantes qui vont te toucher pour sentir à quel point c’est beau d’être connectés comme ça, comme vos corps et vos esprits fusionnent au-delà du monde binaire, et comme vos chattes et vos bites communiquent au plus profond de vos êtres, par le simple pouvoir de vos esprits… tu parles, mon cul ouais !! » On a ri comme des gamines. Elle est sans pareil pour camper des ambiances en quelques coups de pinceau et je n’avais aucun argument pour ma défense. Nous nous sommes connues dans un cours de théâtre et savons toutes les deux avec quelle facilité ce genre d’exercices collectifs, destinés à souder le groupe et faire jaillir les émotions, peuvent devenir une mare visqueuse où se vautrent les cœurs perdus.
Cette nuit, allongée dans les draps froids, la présence du corps de Manuel me manque. J’entends un cliquetis dans le couloir. J’hésite à me lever pour aller voir, mais des peurs infantiles me retiennent. Un grand corps, armé et menaçant, pourrait surgir d’un placard et me dévorer. Mieux vaut rester blottie sous la couette et ne pas se faire remarquer. J’attrape mon téléphone et appelle Manuel. Entendre sa voix me rassure. « Oui, il est tard, je suis déjà couchée, mais j’arrive pas à dormir… Et toi ? » Il raconte leur journée, le dimanche un peu vide en mon absence, les activités de nos filles. Nous avons convenu que je les appellerai trois fois par semaine, pour ne pas les perturber. Il ne parle pas de ma remplaçante au pied levé et du filage du spectacle dont je sais qu’il a dû avoir lieu en cette fin de journée, et j’évite le sujet. Aurais-je préféré qu’il ne me remplace pas et annule tout ? S’il me le demandait, je lui dirais que non. Mais au fond… De toute façon, il ne me demande rien. Son ton est normal, sa voix posée, sa respiration calme. J’entends : « T’inquiète pas, on s’en sort, ça va aller. » Mais j’entends aussi : « Efface-toi de mon esprit, vas-y, disparais. Plante-moi. Mais je ne vais pas rester comme un con à t’attendre. »
Un cliquetis de bracelets résonne dans le couloir. Des pas se rapprochent. Une main frôle le mur de ma chambre. Un bruit de papier froissé qui se transforme en boule dure et tombe sur la moquette rouge sang de l’hôtel, qui l’absorbe et me renvoie au rez-de-chaussée, une boule de flipper qui saute et rebondit, cling, la balle perdue déclenche un clignotement de lumières et de sons, des mains applaudissent, j’entends tinter les coupes que l’on choque les unes contre les autres, du champagne pétille et coule sur mes lèvres, pourtant j’ai tout perdu, mon compteur se retrouve à zéro, mais la joie des autres me contamine malgré tout, je prends dans mes bras un inconnu qui s’écrie : « Enfin, tu t’ouvres à nous, ici les couples n’ont aucune place, ici les cœurs solos se libèrent. L’hôtel aspire ta sève. Tu n’as besoin de personne et l’amour peut couler dans tes veines, sans blesser, sans posséder, sans brimer. » Je ne sais pas si je hurle ou si je pleure, mais je me réveille en sursaut, le cœur battant. Je suis désorientée. C’est la fenêtre qui m’aide à identifier la chambre d’hôtel. Je l’ouvre et sens l’air marin, il me semble entendre le ressac de la marée. J’hésite à sortir me promener le long de la mer en pleine nuit. Une étrange pensée m’assaille : est-ce que j’ai le droit de sortir seule ? Je regarde le réveil. 5 heures du matin, plus que deux heures avant le petit-déjeuner