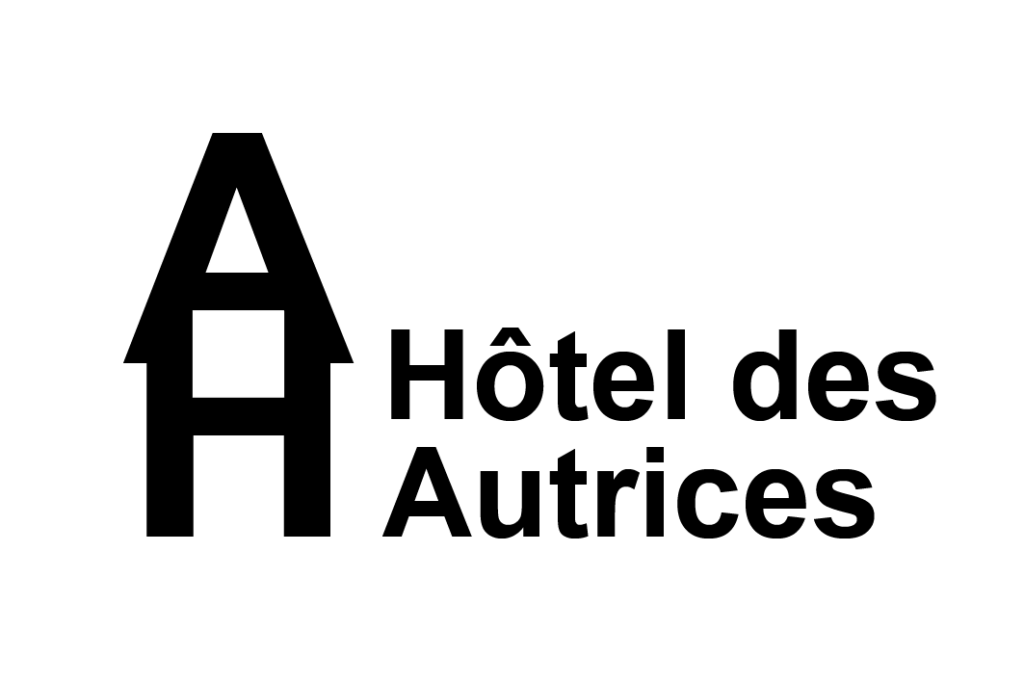Marylise Dumont
2021A012
La femme enfile un t-shirt à pois et se regarde dans la glace. Son reflet est de travers. Le miroir, posé au sol, tient en appui précaire contre le mur de la chambre. Elle soupire et place une jupe noire devant sa taille. Elle hésite en contemplant sa silhouette bancale, puis se ravise et choisit le pantalon qu’elle porte chaque jour depuis une semaine.
Elle s’est inscrite à la réception sous le nom de Diane Dubois. Elle a trente-huit ans. Certains jours, des éclats de jeunesse illuminent son visage, la faisant passer pour une femme de trente ans. D’autres fois, un ciel sombre recouvre ses traits fragiles et la laisse sans âge, déséquilibrée, au bord du ravinement.
Mais ce soir, Diane Dubois est Hélène K. La lettre K pourrait faire référence à l’une des héroïnes livresques de son enfance, Helen Keller, emplie de foi et d’optimisme.
En réalité, ce nom lui est venu à l’esprit en pleine nuit. Vers quatre heures du matin, elle s’était réveillée en train d’essayer de repousser un mur de sa chambre, le front en sueur. Après être allée boire un verre d’eau pour redescendre de cette autre dimension, l’image s’était alors imposée à elle : comme si elle volait au-dessus d’elle-même et de l’édifice entier, elle s’était vue errer dans des couloirs, pendant féminin de Joseph K., prisonnière dans un hôtel pour une raison qu’elle seule ignorait.
Hélène K. descend au bar vers vingt-et-une heures. En poussant la porte du lieu, elle sent monter en elle un frissonnement. Elle doit s’arrêter quelques secondes avant de franchir le seuil. Encore à moitié dans l’ombre, elle observe l’espace qui s’ouvre à elle. Sa respiration se calme peu à peu. Des luminaires, en forme de globes suspendus au plafond, projettent des taches de lumière jaune, çà et là, au-dessus des tables désertes. La plupart des résidents de l’hôtel passent leurs soirées dans leurs chambres. Souvent, dans les couloirs tapissés de velours, les voix des séries télévisées s’échappent des portes fermées et résonnent.
Elle va s’installer au comptoir. Elle se détend et commande un verre de vin. Elle connaît bien cette sensation de serrement dans la gorge, quand elle est trop en attente de quelque chose — qu’elle serait d’ailleurs souvent bien incapable de définir. Mais depuis qu’elle se lève à l’aube pour aller nager dans l’eau fraîche de la piscine, elle respire plus librement.
Assise sur une chaise haute, son buste est légèrement tourné vers la salle. Son regard plonge dans le velours vert des fauteuils, flotte et voyage vers les rangées de bouteilles disposées au-dessus du bar. Les reflets de la lumière scintillent sur le verre et l’étourdissent.
Elle le reconnaît tout de suite : c’est l’homme qu’elle avait remarqué ce matin. Il s’était affalé sur une chaise longue pendant qu’elle faisait des longueurs dans la piscine, tout en faisant tourner entre ses doigts une chose de forme bombée, qui bougeait et semblait vivante. Intriguée, elle avait essayé de se concentrer sur sa nage, mais c’était peine perdue. Ses mouvements étaient contraints. Elle avait envie de sortir de l’eau, mais elle n’avait pas osé, car, comme à son habitude, elle se baignait seins nus dans le bassin vide. Elle avait continué à faire des brasses, tout en pestant contre sa propre servitude, son assignation à ce regard masculin qui l’empêchait de se montrer telle qu’elle était sans craindre d’avoir l’air de chercher à le provoquer.
Lorsqu’elle avait enfin décidé d’assumer sa demi-nudité, s’efforçant de regagner sa serviette d’un pas léger et tranquille, elle n’avait pu s’empêcher de risquer un coup d’œil discret dans sa direction : le transat était vide. Sur la toile à peine froissée, elle avait aperçu un petit jouet ancien à remontée mécanique. En s’approchant, elle avait découvert un oiseau jaune en bois peint à la main, avec des pattes frêles. Elle avait fait tourner la clé pour voir les pattes s’agiter dans le vide. Puis, elle l’avait enveloppé dans sa serviette, comme un trésor.
À présent, elle regarde l’homme du transat s’asseoir à une table, à quelques mètres d’elle. Elle découvre sa silhouette élancée, perçoit son regard gris et doux, ses mains fines. En elle, quelque part, quelque chose s’affole. Elle est bien obligée de reconnaître que la tête lui tourne un peu, que son cœur s’emballe un poil, que sa poitrine se serre un chouia. Et elle n’a même pas touché à son verre de vin.
Elle boit une gorgée, puis se lève et se dirige vers les toilettes pour se dégourdir les jambes.
Devant les lavabos, en se lavant les mains, elle se rappelle soudain qu’Hélène était le prénom de sa meilleure amie, de ses douze ans jusqu’à la fin du lycée. Elle se souvient de ses cheveux roux, de ses formes déjà bien développées et de ses traits anguleux, qui la distinguaient des autres filles de son âge. On la remarquait toujours avant les autres, pense Diane qui lui a emprunté son nom à son insu et comprend qu’il ne s’est pas imposé à elle par hasard. Elle attirait le regard des femmes, d’ailleurs, bien plus que celui des hommes, songe Diane. Elles avaient vécu une amitié passionnée, dont l’intensité les avait dépassées. Les hommes finissaient toujours par en être exclus. Après des années passées à tout partager, Diane avait eu besoin de s’éloigner. Elles ne s’étaient jamais revues depuis leurs dix-huit ans. C’est le moment de rattraper ce qu’elle a laissé partir, ce qu’elle a perdu. Ce soir-là, Diane est déterminée à lui emprunter son magnétisme et la faire revivre à travers elle.
À son retour, elle remarque que l’homme n’est plus à sa place. Il est en train de murmurer quelque chose à Corti Kora, la pianiste de l’hôtel, de l’autre côté du bar. Celle-ci lui sourit d’un air entendu, boit une gorgée, et attaque un nouveau morceau. Elle est vêtue d’une robe mauve pailletée. La mélodie est enjouée, le rythme rapide. Les doigts de la pianiste rebondissent et sautent de touche en touche, sa tête bat la mesure. Une mazurka.
Entre-temps, l’homme est allé se rasseoir à sa table, et une femme se tient en face de lui. Elle a des cheveux noirs, relevés avec une pince, et porte des lunettes aux verres teintés. Hélène met du temps à reconnaître Belloncée. L’homme et Belloncée se regardent. Belloncée a enlevé ses lunettes. Ils restent quelques secondes ainsi, sans parler. Puis, Belloncée prend la main de l’homme dans la sienne. Hélène croit deviner qu’ils sont émus. Elle est gênée. Même à distance, elle se sent comme une intruse. Elle détourne les yeux, et aperçoit sur le sol un mouchoir en dentelle, comme échappé d’un monde ancien. À présent, les accords d’un morceau de blues au tempo alangui s’étirent, avec indolence et mélancolie.
Un frottement de hanche involontaire la tire de sa rêverie. C’est Belloncée, qui se presse vers le bar pour commander une bouteille de champagne, heurtant son verre de vin.
« Oh, je suis désolée ! Je ne suis pas dans mon assiette ce soir… »
À son tour, Belloncée remarque le mouchoir. Elle le ramasse et le tend à Hélène.
« Je me demandais où il était passé. J’ai dû l’oublier hier soir. Je passe toutes mes soirées ici…, ironise-t-elle. Il appartenait à ma mère, vous pouvez vous essuyer avec, ça va vous porter chance. »
Hélène est touchée mais hésite, gênée de salir le tissu blanc, troublée de tenir entre ses mains ce mouchoir ayant appartenu à la mère de Belloncée, réceptacle intime de ses larmes, sa morve, sa sueur, ses microbes, sa honte et son chagrin…
Elle frotte machinalement son pantalon bleu. La tache rouge-noir s’étale encore plus.
« Vous attendez quelqu’un ? »
La voix de Belloncée coupe court aux divagations d’Hélène.
Le ton est dubitatif, laissant entendre le contraire — « Évidemment vous n’attendez personne, hein. »
Belloncée enchaîne : « Venez boire un verre avec nous, ça nous changera les idées. Vous aimez le champagne ? »
Belloncée pose les règles du jeu. Qui sera la proie, qui la chasseresse…
Hélène s’entend murmurer avec flamme : « Oh oui ». Elle constate qu’elle se délecte d’être leur jouet. Oh que oui j’aime le champagne. Les bulles surtout. Qui frétillent, claquent, picotent. Ces mini-explosions dans la gorge dont elle raffole. Et les joues qui rosissent, le rire qui se loge au creux de la poitrine et ne part plus, les regards pétillants, en coin ou assumés, les mots de trop qu’on dit et ceux qu’on a oubliés, la légèreté, la douce amertume, le jamais assez qui finit par vous trahir…
Lorsqu’elle se retrouve à leur table, elle ne sait plus vers qui tourner son regard. Elle est fascinée par Belloncée, chez qui elle pressent un mystère et une force de caractère insondable. Et l’homme en face d’elle, dont elle apprend vite qu’il s’appelle Stan, l’attire sans qu’elle comprenne encore pourquoi.
Stan et Belloncée échangent un baiser furtif et trinquent en direction d’Hélène. Hélène rougit. Un vieux réflexe. Pourtant, elle ne se sent pas de trop, et elle n’aimerait échanger sa place pour rien au monde. Tous trois lèvent leurs verres.
« Alors, qu’est-ce que vous faites ici, Hélène, seule, et pour combien de temps vous êtes là ? »
Pour la première fois, Stan la regarde dans les yeux, avec un sourire amusé. Une invitation au jeu claire et franche.
Hélène brûle de passer la frontière et aller voir de l’autre côté. Elle imagine une danse avec ces deux êtres qu’elle connaît à peine. Elle se projette dans l’ancienne salle de bal, ôtant ses pantoufles de vair, tournoyant sur elle-même. Arc-boutée sur une identité poreuse, elle valse d’un corps à l’autre — tantôt éprise du torse, des bras et épaules solides, du sexe qu’elle sent durcir, cherche et caresse, tantôt amoureuse de ces seins si semblables et si différents, de ces hanches aux douces courbes, de ces fesses-collines. Baisers langoureux et interminables, d’une bouche à l’autre, leurs langues assoiffées se mêlent et relancent leurs jouissances. Les contours se diluent. Le parquet de la salle de bal recueille leurs corps amollis, repus, alanguis, échevelés, à bout de souffle.
La complicité qui relie ces deux êtres est contagieuse. Peu importe qu’Hélène ne puisse savoir si Stan était un amant de passage de Belloncée, ou un vieil amant revenant visiter sa vie de temps en temps, avant que chacun reprenne sa route. Hélène les désire tous les deux.
Plus tard, ils iront dans la salle de bal et danseront.
Ils finiront par s’écrouler au petit matin, inertes et enlacés, sourds aux pépiements des oiseaux.
Lorsque Corti Kora les découvre, quelques heures plus tard, en passant devant la porte entrouverte pour aller jouer son Ostinatôt, elle remarque qu’ils se tiennent tous trois la main, et n’ose pas les réveiller.