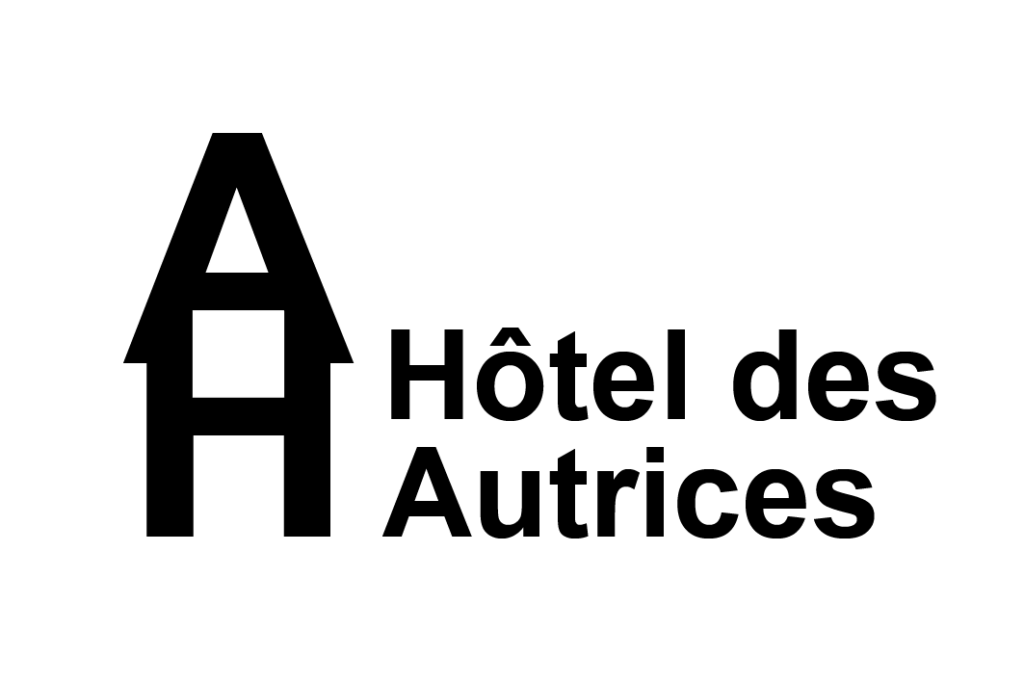Marylise Dumont
2021A007
Ce matin, j’ai découvert que les poissons du bassin de l’hôtel avaient été remplacés par des tortues de Floride.
J’ai failli trébucher dans le gravier, tant ma surprise a été grande. J’étais en chemin pour aller me baigner.
Leurs tempes rouges. Impossible de s’y méprendre, même à travers l’eau verdâtre. J’en ai aperçu deux, mais je ne me suis pas arrêtée pour les compter. Peut-être qu’il y en avait plus… J’ai filé aussi vite que mes pieds nus me le permettaient.
Je ne me souviens plus si j’avais pouffé de rire lorsque mon frère nous avait dit quel nom il avait donné à sa tortue de Floride : Auguste. Il l’avait récupérée à une tombola. Tiens, prends ça, gamin, c’est tes parents qui vont être fiers. Mon frère l’avait sortie d’un sac en plastique noué à l’aide d’un joli ruban bleu, rempli d’eau ; on s’attendait à découvrir un poisson rouge. Il nous l’avait montrée, tenant la carapace entre ses doigts d’un air triomphant, s’écriant : « Je l’ai gagnée ! » Puis, il s’était mis à fouiller dans son sac à dos pour nous montrer le minuscule aquarium qu’il venait d’aller s’acheter, avec son argent de poche, à l’animalerie en face de l’école. Je revois nos visages penchés au-dessus de la minuscule créature sans âge, la tête rentrée dans sa cuirasse. Elle était si mignonne ! Seule ma mère avait froncé les sourcils en voyant la taille du bocal. Je l’entends encore dire à mon père d’une voix anxieuse : « Elle va devenir monstrueuse ! Qu’est-ce qu’on va en faire ? »
Les jours suivants, un épais volume du dictionnaire universel d’histoire naturelle hérité de mon grand-père traînait sur la table du salon, et bientôt, je savais tout sur la Trachemys scripta elegans. J’appris ainsi que l’élégance de cette trachémyde, alias tortue d’eau douce rugueuse, était liée à cette bande rouge orangé sur sa tête, et que cette espèce était dite à oreilles rouges, tempes rouges, ouïes rouges ou tympans rouges. Ces drôles d’appellations me faisaient penser à des noms de chefs amérindiens : j’imaginais la tortue, les tempes chauffées par la colère et la passion guerrières, la tête couronnée d’un panache de plumes d’aigle, avançant cahin-caha dans les Grandes Plaines, sous un soleil écrasant. Le terme « scripta », faisant référence aux fines lignes qui ornaient sa carapace comme des dessins ou des écritures, venait étoffer de mystère ces rêveries épiques et cocasses.
Ce que j’ignorais, c’est que quelques années plus tard, elle serait officiellement considérée comme une espèce invasive.
J’avais un frère amoureux des Chéloniens. L’élue de son cœur était une trachémyde écrite élégante, et elle portait le nom sacré d’Auguste. Exclue de cette passion, j’ai commencé à me méfier de la créature. Était-ce un, était-ce une ? Je ne l’ai jamais su. En tout cas, écrite ou pas, l’élégance de cet animal à la bouche ouverte gobant par grappes des larves de moustique, vers de terre et crevettes, s’est mise à me dégoûter. Les années passaient, et la fascination de mon frère me questionnait : pourquoi n’avais-je plus le droit d’entrer dans sa chambre sans frapper ? Était-ce l’arrivée de cette tortue qui avait provoqué la mue soudaine de sa voix ? Vexée, je refusais obstinément de nourrir la tortue de mon frère quand il me le demandait, et c’était ma mère qui finissait toujours par le faire, excédée. Et Auguste grossissait. Bientôt, le bureau entier de mon frère s’est mué en aquarium gigantesque, dégageant une moiteur irrespirable avec son tube fluorescent. « C’est un bassin en extérieur qu’il lui faut ! », enrageait ma mère. Mon frère ne cédait pas. Jusqu’à ce que cette espèce soit interdite en Europe, et que ma mère saute sur l’occasion pour s’en débarrasser.
Aucun de nous n’a jamais su ce qu’elle en avait fait. Un matin, la tortue et ma mère avaient disparu. Ma mère était rentrée seule, quelques heures plus tard, les traits tirés, l’air coupable. L’avait-elle relâchée dans l’étang le plus proche, comme le firent la plupart des personnes détentrices de tortues de Floride ? Mon frère était hors de lui. Ma mère brandissait la loi pour justifier son acte. Je n’ai jamais osé lui poser la question.
J’ai la tête qui bourdonne depuis que je les ai vues flotter dans l’eau marécageuse. Il était sept heures moins dix quand je suis arrivée en bas. J’aime me baigner tôt, puis remonter dans ma chambre et profiter d’une douche bien chaude avant d’aller m’éterniser dans la salle du restaurant pour la dernière heure du petit déjeuner.
Je fais toujours un détour par le petit jardin qui se trouve derrière la piscine. Je marche à pas précipités jusqu’au portail, comme une voleuse, car je tiens à être pieds nus. Depuis que je suis arrivée à l’hôtel pour me mettre sous cloche, j’essaie d’endurcir ma peau de citadine. Et je remarque que mes pieds se dilatent, loin des quais de métros et des trottoirs en bitume. Alors je me dépêche, pour éviter que les cailloux me blessent. Une fois arrivée dans le petit jardin, je savoure le contact de l’herbe et la rosée sur mes pieds. Cette douceur un peu humide.
Ce matin, je suis passée devant le bassin en coup de vent, dans la brume de l’aube, sans vraiment regarder dedans. C’est le rouge qui m’a alertée. J’ai même ralenti pour mieux voir, mais je n’ai pas osé m’approcher. J’ai eu peur du carnage. Depuis quelques jours, cette affaire des poissons morts s’est propagée dans l’hôtel comme un chancre. Les résidents s’en sont saisis pour dissimuler leur ennui avec une telle voracité, ça m’a troublée. On ne parle plus que de ces carpes. Si bien que je me suis mise à avoir honte, moi, cœur froid, de ne pas ressentir de peine face à l’outrage qui a sans doute été fait à ces poissons. Ont-ils été découpés par un sadique, comme l’a susurré Corti Kora à l’oreille de Belloncée hier matin, lorsque je suis passée derrière elles pour attraper la thermos et me servir une tasse de café ? L’avantage, avec les poissons, c’est qu’on ne peut pas les démembrer, n’ai-je pu ensuite m’empêcher de songer, en mangeant ma tartine beurrée au petit déjeuner. J’avais envie de saumon frais ce matin-là. On n’avait pas mangé de poisson depuis des jours. Les cuisiniers sont en deuil. Je me fiche complètement du carême, mais j’ai peur de ne plus jamais oser planter ma fourchette dans un poisson. Je m’étais bien dit que j’irais jeter un œil dans les poubelles avant d’aller me baigner, histoire de vérifier que les carpes dépecées n’y étaient pas. Mais chaque matin, depuis cette disparition, je renonce à ce projet, pressée de sentir l’eau froide réveiller mon corps endormi.
Je me baigne à moitié nue. Quelques fenêtres donnent sur la piscine, mais je prends toujours soin de vérifier que les rideaux sont fermés. Peu de plaisirs égalent celui de sentir mes seins se déployer dans l’eau. Ils ont beau ne pas être particulièrement gros, j’aime me délester d’eux. Je les tire dans mon sillon, ma nage les traîne et les laisse tout plats, écrasés, séparés. Jamais ils ne s’écartent autant l’un de l’autre qu’en ces moments-là. Je m’élance dans l’eau, femme sans attache aux seins libres, et je me moque bien de toutes les bretelles, armatures, fermoirs et baleines contraignantes, saillantes ou rigides.
Je me suis donc baignée. Comme si je n’avais rien vu de spécial ce matin-là, j’ai commencé à faire mes mouvements préférés : j’étire mes bras et tends mes jambes de tout mon élan pour glisser le plus loin possible, puis je prends une longue inspiration, et je plonge. Je reste chaque fois un peu plus longtemps sous l’eau, avant de ressortir la tête pour happer l’air, haletante. Je recommence plusieurs fois de suite, sans réfléchir, j’enchaîne, je repars, je reglisse, je replonge et je m’enfonce. Enivrée par cette sorte d’engourdissement des sens où les sons se dissolvent, où la myope que je suis se délecte de voir les contours s’estomper, je transfuse en moi le sang bleu de la piscine.
J’ai été rattrapée par les pensées tortuesques. Comment les tortues s’étaient-elles infiltrées dans le bassin de l’hôtel ? L’établissement avait-il une autorisation spéciale d’élevage de tortues de Floride ? Avais-je bien vu ? Ou étaient-ce ces marques rouge vif derrière l’œil, si familières, qui avaient provoqué ma panique et fait ressurgir l’angoisse infantile de voir Auguste revenir et se venger — de moi qui avais refusé de la nourrir, et de ma mère qui avait tenté de l’éliminer ? Peut-être avais-je simplement confondu deux minuscules objets rouges voguant à la surface de l’eau, avec les taches rougeâtres de la tortue dite à oreilles rouges ? Je pensais soudain à l’oreille coupée de Blue Velvet, abandonnée aux insectes dans un champ.
C’est à ce moment-là que j’ai aperçu une forme humaine près de la chaise longue vide sur laquelle j’avais posé ma serviette. Même floue, la silhouette était celle d’un homme. Un jeune homme, j’aurais dit. Une petite trentaine. Je ne l’avais jamais vu. J’ai continué à nager, sans laisser paraître mon étonnement, tout en modérant l’enthousiasme que je prenais à me laisser glisser, m’efforçant de nager sur le ventre pour dissimuler mes seins nus. Comme si le regard potentiellement posé sur moi pouvait tout changer. Jusqu’ici, je n’avais croisé que des femmes dans l’hôtel. Si Belloncée, la pianiste, la psychologue, la voyante, la directrice et Alice venaient toutes s’asseoir sur ces chaises longues, les seins nus, nous serions souveraines. J’ai fait quelques longueurs et me suis laissée couler. Du fond de l’eau, j’imaginais ma sortie, les seins indomptés, telle une naïade impudente et sauvage. Je me rêvais tortue, faisant exploser en mille morceaux mon antique carapace. Os, cartilages et écailles disséminées, partout dans la piscine. Je sors la tête de l’eau pour aspirer à pleins poumons. Je regarde dans sa direction. L’homme tient quelque chose entre ses doigts. Je n’arrive pas à voir de quoi il s’agit, mais on dirait que c’est un objet dur, avec des sortes de pattes courtes qui semblent bouger.